Mode «post-soviétique»: le nouvel empire du cool<
Auparavant, quand on devait se constituer une image stéréotypée du style post-soviétique, on prenait comme base une femme à la chevelure souple et blonde, dotée d’une bouche pulpeuse, d’un regard bleu comme les eaux du Baïkal, d’une taille fine surmontée d’une poitrine plantureuse et suivie de jambes interminables. On affublait ensuite la poupée de tissus moulants et courts, le tout monté sur des talons vertigineux. Et pour les hommes, la référence ultime était un homme musclé, torse nu sur un cheval.
Mais ça, c’était avant. Avant que ne déferle sur la fashionsphère de jeunes designers faisant souffler sur la mode un vent d’Est. Les noms les plus connus de cette avant-garde sont Demna Gvasalia, fondateur et directeur artistique de la marque Vetements (également à la tête de la création de Balenciaga), Gosha Rubchinskiy et la consultante-styliste-mannequin Lotta Volkova. Une nouvelle génération de créateurs qui ne font pas dans le bling-bling mais veulent promouvoir, selon leurs dires dans les médias, une «élégance alternative».
Une inspiration de 1990
Qui se traduit par un look baptisé «post-soviétique» par les prescripteurs et s’inspirant très largement de celui des banlieusards désargentés des pays de l’ex-bloc soviétique dans les années 1990 (le «gopnik» en russe): un mélange de sportswear (training, pull à capuche, logo imposant) et vêtements de travail, le tout en version oversize, truffé de détails et références exotiques (inscriptions en lettres cyrilliques, marteaux et faucilles).
Ce style repose sur un storytelling authentique et redoutablement efficace d’un point de vue marketing. Exemple? Le t-shirt jaune au logo DHL de la marque Vetements, une création vendue autour de 250 francs (contre 6,50 dollars pour celui vendu sur le site de l’entreprise de livraison) et épuisée en quelques semaines après son arrivée en boutique.
Lire aussi:Demna Gvasalia, la mode du futur
Nouvelle vague
«La mode est toujours en quête d’idées neuves, commente Djurdja Bartlett, professeur en Histoire et Culture de la mode au London College of Fashion. Des créateurs comme le Russe Gosha Rubchinskiy ou le Géorgien Demna Gvasalia, qui puisent leurs références visuelles dans le quotidien de la période post-soviétique, ont apporté à l’industrie en 2016 l’énergie nouvelle qu’elle recherchait.» La fin de l’URSS marque le début d’une période d’émancipation et d’ouverture pour la jeunesse des années 1990, qui découvre alors la pop culture de l’Ouest – notamment MTV et les marques de sportswear américaines – et s’en réapproprie les codes, à l'image de la révolution stylistique et contestataire des punks dans les années 1970.
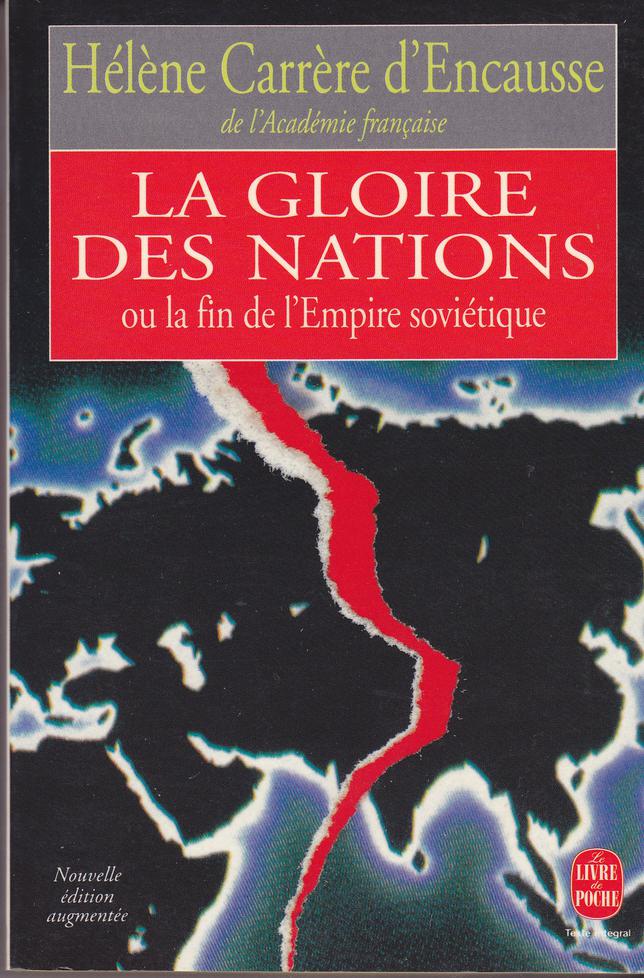
Turn your #porch into a second living room with a #DIY porch swing. We'll show you how to build one in a weekend wi… https://t.co/THav3BgLgv
— Happy Heart Thu Aug 01 08:56:16 +0000 2019
«C’est intéressant d’observer comment cette tendance s’infiltre dans la culture mainstream, dans les magazines par exemple avec des bâtiments brutalistes servant de décor à des shootings de mode, chez Topshop où se multiplient les vêtements portant des lettres cyrilliques et la montée en puissance de l’intérêt général pour ce mythe de la nouvelle vague post-soviétique», illustre la journaliste russe basée à Londres Anastasiia Fedorova, qui écrit notamment pour Dazed, I-D, Vice, The Guardian ou encore Business of Fashion.
D’est en ouest
A l'instar d’autres régions du monde, la Russie se détourne d’une mode ostentatoire pour lui préférer une création plus intellectuelle, portée par de jeunes designers du pays qui utilisent le vêtement comme vecteur d’expression personnelle, voire politique.
Une vision très éloignée du luxe statutaire qui a fait rage auprès des nouveaux riches russes dans les années 2000. «Après la dissolution de l’URSS, les années de la Perestroïka sous Mikhaïl Gorbachev (1985-1989) ont permis l’ouverture des canaux de communication avec l’Occident, et à la créativité des citoyens des pays de l’ex-bloc soviétique de s’exprimer enfin, développe le professeur Djurdja Bartlett. Rubchinskiy, Gvasalia et Lotta Volkova, qui ont grandi durant cette période, étaient aux premières loges pour observer et être marqués par ces changements culturels et esthétiques, la libéralisation du marché et des mœurs, l’arrivée dans les magasins des marques américaines, etc.»
Un bagage d’influences mêlées qu’ils emportent en quittant leur pays d’origine pour gagner l’Ouest, et notamment Paris, où ils affinent leurs compétences techniques et leur compréhension de l’industrie de la mode. Pour mieux la prendre d’assaut. «Rubchinskiy est né en 1984 à Moscou, Demna et son frère, le CEO de Vetements Guram Gvasalia, dans une petite ville de Géorgie en 1981 et 1985 et Lotta Volkova en 1984 à Vladivostok. Mais c’est à Paris qu’ils se sont tous rencontrés, en faisant la fête, et c’est aussi là qu’ils ont rencontré le succès.»
Enfants terribles
Pour les jeunes créateurs originaires de Russie et des pays de l’ex-bloc soviétique, l’avènement de la tendance «post-soviétique» est une sorte de revanche. «Bien sûr que la création – qu’il s’agisse de mode, d’art, d’architecture ou encore de musique – est régie par des cycles de popularité, mais il n’empêche que l’énergie nouvelle en provenance de l’ex-bloc soviétique est une diversification qui fait énormément de bien: cela montre que les talents ne se trouvent pas qu’à Londres, Paris ou New York», se réjouit Thomas Beachdel qui a cocuratéavec l’artiste tchèque Marie Tomanova «Youth Explosion: The New Bohemia» en 2016 au Czech Center de New York.
Le trend «post-soviétique» rend les artistes des pays de l’ex-bloc soviétique hautement désirables, les transforme en rebelles ultra-cool que tout le monde veut côtoyer. Ce qui n’est pas pour déplaire aux créateurs, qui se sentent appartenir au mouvement. «On est un peu comme des adolescents un peu agressifs mais curieux de tout. Il y a tellement de choses que nous ne faisons que de découvrir, ça attise l’intérêt des gens», s’exclament la photographe Turkina Faso et la designer Asiya Bareeva, qui toutes deux travaillent entre Londres et Moscou.
«Fétichisation des classes ouvrières»
La tendance, en passant au crible du marketing la pauvreté des banlieues, opère une commercialisation de la misère qui soulève plusieurs questions. «La fétichisation des classes ouvrières est problématique d’un point de vue éthique, admet Anastasiia Fedorova, qui a énormément écrit à ce sujet. Nombreuses sont les personnes qui se sentent offensées par cela. Personnellement, ce n’est pas ce qui me choque le plus. Ce qui est intolérable, c’est que l'on place sous la même bannière «post-soviétique» des créateurs originaires de pays comme l’Ukraine et la Géorgie. Ces nations ont suffisamment souffert. Leur faire porter cette étiquette, c’est avoir une vision complètement post-coloniale de la géopolitique, une manière de nier le passé de ces pays.»
Une nuance qui a certainement échappé à la plupart des acteurs de l’industrie de la mode, peu intéressés par ces considérations politiques. Et d’ailleurs, pourquoi s’énerver autour d’un terme voué à se faire détrôner par le suivant? «Quand on me parle de cette tendance post-soviétique, je ne peux m’empêcher de penser à l’exposition du Metropolitan Museum de New York en 2013 «Punk: Chaos to Couture», évoque Thomas Beachdel.
Cet accrochage consistait en fait en une gigantesque promotion pour les annonceurs des magazines de Condé Nast et absolument pas en une monographie consacrée au style punk et à son contexte politique (le Royaume-Uni dans les années 1970, les grèves et le désordre durant l’Hiver du Mécontentement, le Tatchérisme, les chiffres affolants du chômage...). Le trend «post-soviétique» est pour moi tout aussi peu engagé politiquement. Il suffit de penser aux prix des habits de Vetements: aucun des jeunes de banlieue dont la marque s’inspire ne peut se les payer!.»


 Mots clés:
Mots clés: PRÉC
PRÉC







