Aaron Swartz, les mystères d'un idéaliste<
Temps de lecture: 71 min
Le 4 janvier 2013, Aaron Swartz s’est réveillé d’excellente humeur. «Il s’est tourné vers moi», se rappelle sa petite amie Taren Stinebrickner-Kauffman, «et a déclaré de but en blanc: “Cette année va être géniale”.»
Swartz avait des raisons d’être optimiste. Depuis un an et demi, il était mis en examen pour fraude informatique, épreuve apparemment interminable qui avait épuisé ses ressources tant financières qu’émotionnelles. Mais il avait de nouveaux avocats, qui travaillaient dur pour trouver un terrain d’entente avec le gouvernement. Peut-être allaient-ils conclure un accord acceptable. Peut-être iraient-ils devant les tribunaux et gagneraient-ils.
«On va gagner, et je vais me remettre à travailler sur toutes les choses qui m’intéressent», avait confié Swartz à sa petite amie ce jour-là. Non qu’il ait été oisif. Outre son travail pour la société internationale de consulting informatique ThoughtWorks, il était devenu rédacteur pour le magazine The Baffler, avait fait des recherches d’une portée conséquente sur la manière de réformer la politique sur la drogue et était venu à bout de près de 80% d’un énorme résumé de l’intrigue du roman Infinite Jest.
Mais Swartz mettait la barre très haut et il y avait toujours plus à faire: de nouveaux livres à lire, d’autres programmes à écrire, de nouvelles façons de contribuer aux innombrables projets dans lesquels il s’était engagé.
Cheerios sans rien et pizza au fromage
Swartz et Stinebrickner-Kauffman avaient commencé 2013 par des vacances au ski dans le Vermont. La fille de l’ex-petite amie de Swartz, la journaliste spécialiste des nouvelles technologies Quinn Norton, les y avait rejoints. Swartz aimait cette petite plus que n’importe qui au monde.
Il adorait les enfants, et à l’occasion se comportait lui-même en gamin. Difficile jusqu’à la pathologie, il ne mangeait que des aliments fades: des Cheerios sans rien, du riz blanc, les pizzas au fromage de Pizza Hut. Il disait à ses amis être un «supergoûteur», extraordinairement sensible aux goûts —comme si ses papilles subissaient constamment le choc de passer d’une pièce obscure à une lumière vive.
Bien qu’il se qualifiât de «spécialiste en sociologie appliquée», Swartz était surtout connu en tant que programmeur informatique. Son projet en cours, un logiciel qu’il avait baptisé Victory Kit, était sur la bonne voie. Victory Kit devait être une version open-source gratuite de l’onéreux logiciel d’organisation communautaire utilisé par des groupes comme MoveOn —le genre de logiciel utilisable par les activistes du monde entier.
Certains de ces activistes étaient venus écouter Swartz présenter Victory Kit lors d’une conférence dans le nord de l’État de New York le 9 janvier. Mais à la dernière minute, il avait décidé de ne pas prendre la parole.
Son ami Ben Wikler raconte que son intervention dépendait de l’engagement d’une autre personne à s’accorder avec lui pour que leur code soit en open source. N’ayant pas réussi à obtenir cet engagement à temps, Swartz avait décidé de renoncer à son intervention. «Je me rappelle que son immobilisme m’a énervé», raconte Wikler.
La possibilité d’un mariage
Swartz avait des principes auxquels il tenait beaucoup. «Aaron pensait généralement qu’être pointilleux sur ce genre de choses rendait le monde meilleur, parce que cela poussait vraiment les gens à faire les bons choix», rapporte Wikler.
Il ne signait jamais aucun contrat susceptible d’encourager le patent trolling. Il avait des idées très arrêtées en termes de vêtements et portait des t-shirts chaque fois qu’il le pouvait. «Les costumes», écrivit-il sur son blog, «sont la preuve physique de la distance hiérarchique, la validation d’une forme particulière d’inégalité».
Il n’était pas dogmatique sur tous les sujets. Opposé au mariage depuis toujours, il commençait à se dire qu’il s’était trompé. Le vendredi 11 janvier, Stinebrickner-Kauffman fit une halte chez Wikler. Elle et Swartz devaient venir dîner plus tard dans la soirée, mais elle était passée toute seule avant.
Tout en jouant avec le nouveau-né de Wikler, elle mentionna que Swartz lui avait dit qu’après la fin de l’affaire, il se pourrait qu’il envisage le mariage. Si ça c’était possible, alors rien n’était impossible.
Mais à moins de trois kilomètres de là, dans un petit studio obscur, Aaron Swartz était déjà mort.
Au début de chaque année, Aaron Swartz mettait en ligne une liste de tout ce qu’il avait lu au cours des douze mois précédents. Sa liste pour 2011 comprenait 70 livres, dont douze étaient pour lui «si géniaux que mon cœur saute de joie à l’idée de vous en parler même maintenant».
L’un d’entre eux était Le Procès de Franz Kafka, l’histoire d’un homme piégé dans l’engrenage d’une vaste bureaucratie, confronté à des accusations et à un système défiant toute explication logique. «Je l’ai lu et je l’ai trouvé extrêmement exact —chacun des détails reflétait parfaitement ma propre expérience», s’émerveillait Swartz. «Ce n’est pas de la fiction, c’est un documentaire.»
Lorsqu’il est mort, Swartz avait 26 ans et faisait depuis deux ans l’objet de poursuites du Département de la Justice. En juillet 2011, il fut accusé d’avoir accédé au réseau informatique du MIT sans autorisation et de l’avoir utilisé pour télécharger 4,8 millions de documents de la base de données en ligne JSTOR. Pour le gouvernement, ses actes relevaient du code pénal américain et lui faisaient encourir une peine maximale de 50 années de prison et 1 million de dollars d’amende.
Des questions sans réponses
Cette affaire avait miné les finances de Swartz, son temps et son énergie mentale et engendré chez lui un sentiment d’isolement extrême. Même si ses avocats travaillaient dur pour parvenir à un accord, la position du gouvernement était claire: quel que soit l’accord convenu entre les deux parties, il faudrait qu’il inclue au moins quelques mois de prison.
Une mise en examen prolongée, un plaignant intransigeant, un cadavre —voici les faits. Qui sont dépassés par les questions soulevées par la famille, les amis et les supporters de Swartz depuis son suicide. Pourquoi le MIT a-t-il absolument tenu à porter plainte? Pourquoi le département de la Justice a-t-il été si strict? Pourquoi Swartz s’est-il pendu avec une ceinture, choisissant de mettre un terme à sa vie plutôt que de continuer à se battre?
Backlog / Quinn Norton via Flickr CC License By
En se tuant, on abandonne le droit de contrôler sa propre histoire. Dans les rassemblements, sur les forums et dans les médias, vous entendrez dire que Swartz a été abattu par la dépression ou qu’il s’est retrouvé pris au piège d’une bataille politique, ou qu’il était victime d’un État vindicatif.
Une cérémonie en sa mémoire, tenue à Washington début février, s'est transformée en bataille autour de son héritage, où les endeuillés se criaient dessus leur désaccord sur les changements de politiques à entreprendre pour honorer sa mémoire.
Le laisser se développer, et le détruire
Le cas Aaron Swartz est un sacré casse-tête. C’était un programmeur résistant à toute description, un millionnaire.com qui vivait dans un studio en location. Il pouvait être tout à la fois un collaborateur gênant et un expert efficace pour repérer les problèmes. Il avait le don de se faire des amis puissants et de les faire fuir. Il avait des dizaines de centres d’intérêt et se consacrait à chacun d’entre eux.
En août 2007, il écrivit sur son blog qu’il s’était «engagé à élaborer un catalogue complet de tous les livres, écrire trois livres (projet largement abandonné entre-temps), [se] renseigner sur un projet à but non-lucratif, aider à la réalisation d’une encyclopédie des métiers, créer un nouveau weblog, fonder une startup, servir de mentor à deux ambitieux projets Google Summer of Code (restez branché), construire un clone de Gmail, créer une nouvelle liseuse en ligne, débuter une carrière de journaliste, faire une apparition dans un documentaire et faire des recherches et coécrire un article». Et sa productivité s’était retrouvée entravée parce qu’il était tombé amoureux, ce qui «prend un temps monstrueux!».
Il était fasciné par les grands systèmes et par la manière dont la culture et les valeurs d’une organisation pouvaient engendrer innovation ou corruption, collaboration ou paranoïa. Pourquoi un groupe de professeurs et de professionnels accepte-t-il de traiter un gamin de 14 ans comme son égal tandis qu’un autre passera deux ans à s’acharner dans un procès totalement disproportionné par rapport au soi-disant crime commis? Comment un type d’organisation peut-il laisser se développer un jeune homme comme Aaron Swartz, et un autre le détruire?
Le besoin de réparer
Swartz croyait aux vertus de la collaboration pour aider les organisations et les gouvernements à mieux travailler, et ses premières expériences en ligne lui avaient montré que c’était possible. Mais il avait plus de talent pour commencer les choses que pour les terminer. Il voyait les obstacles aussi bien que les opportunités, et ces obstacles venaient souvent à bout de ses forces.
Aujourd’hui, dans la mort, son refus du compromis prend un nouveau visage. C’était un idéaliste, et ses nombreux projets —achevés et inachevés— sont un témoignage des barrières qu’il avait mises à bas et de celles qu’il tentait de repousser. C’est l’héritage d’Aaron Swartz: quand il pensait que quelque chose était cassé, il essayait de réparer. S’il échouait, il essayait de réparer autre chose.
Huit ou neuf mois avant sa mort, Swartz fit une fixation sur Infinite Jest, l’énorme et complexe roman de David Foster Wallace. Il pensait pouvoir démêler les fils de l’intrigue et les assembler en un tout cohérent et facilement décomposable.
C’était un problème difficile, mais il pensait pouvoir le résoudre. Comme son ami Seth Schoen l'écrivit après sa mort, Swartz pensait qu’il était possible «d’arranger le monde principalement en l’expliquant soigneusement aux gens».
Ce n’est pas que Swartz ait été plus intelligent que la moyenne, explique Taren Stinebrickner-Kauffman —il posait simplement de meilleures questions. Projet après projet, il enquêtait et bricolait jusqu’à extirper les réponses qu’il cherchait. Mais au final, il s’est retrouvé avec un problème insoluble, un système qui n’avait pas de sens.
Aaron Swartz est né en novembre 1986. L’aîné de trois frères, il grandit à Highland Park, Illinois, banlieue aisée à 37 km au nord de Chicago, dans une grande et vieille maison de style faux Tudor dans une propriété boisée, non loin du terrain accueillant le festival de musique estival Ravinia.
Robert, son père, était consultant en informatique, et sa mère, femme au foyer, adorait le tricot et les travaux de perles. Son grand-père, William Swartz, présidait une entreprise d’enseignes et s'était engagé dans Pugwash, organisme prônant le désarmement qui remporta le prix Nobel de la Paix en 1995.
«L’idée d’essayer de faire le bien et de rendre le monde meilleur imprégnait notre manière d’envisager les choses», raconte Robert Swartz. «L’idée de ne pas nous intéresser aux objets, à l’argent, aux acquisitions était notre façon de voir le monde.»
Aaron était un enfant précoce, qui sut lire très tôt. À 3 ans, se souvient son père, il lut un papier sur le réfrigérateur et demanda à sa mère ébahie: «C’est quoi cette fête gratuite pour les familles dans le centre-ville de Highland Park?»
Quand il eut l’âge d’aller à l’école, il intégra la North Shore Country Day School (NSCDS), une école privée pittoresque de Winnetka, dans l’Illinois. L’école était à 9 km de chez lui, il n’était donc pas facile pour ses copains de venir jouer à la maison. Aaron trouva des moyens de s’amuser tout seul —en jouant du piano, en lisant, en s’amusant avec ses frères.
Fasciné par les énigmes
Très jeune, il se montra expert dans la manipulation des machines et fasciné par les énigmes. «Petit, il s’intéressait aux carrés magiques—des carrés de 3 par 3, où dans toutes les directions les chiffres additionnés donnent le même résultat», se rappelle Robert Swartz:
La famille Swartz fut l’une des premières du coin à avoir un accès Internet, avant l’avènement des navigateurs graphiques. Aaron eut des ordinateurs très tôt et il se trimballait un énorme ordinateur portable de classe en classe.
Il construisait des sites Internet pour lui tout seul (aaronsw.com), pour sa famille (swartzfam.com), pour les gens intéressés par «les montagnes russes de l’affaire contre Microsoft» (Redmond Justice), pour ceux qui voulaient convertir du texte en code ASCII binaire et de nouveau en texte (Binary Translator) et pour le fan club de Star Wars Chicago Force.
«Il est venu à un Conseil de Jedi (nom que nous donnions à notre conseil d’administration) un jour, ses parents l’avaient déposé», se souvient Phillip Salomon, un membre du groupe. Son premier pseudo AIM fut «Jedi of Pi».
C’est vers cette époque qu’Aaron commença à s’ennuyer à l’école. «Il venait me voir pour me demander des choses à lire», raconte Robert Ryshke, directeur du lycée de NSCDS de 2000 à 2005:
Swartz était convaincu que North Shore Country Day ne répondait pas à ses besoins (ni à ceux d’aucun autre élève). À l’été 2000, juste avant qu’il ne commence le lycée, il lança un blog appelé Schoolyard Subversion. «Sérieusement, qui se soucie vraiment de la longueur du Nil, où de qui a découvert le fromage?», pouvait-on y lire:
Malgré sa petite taille, son intelligence surnaturelle et son côté iconoclaste, Swartz n’était pas isolé socialement. Il avait des amis, participait à des Olympiades scientifiques et à des équipes sportives.
Des vidéos de classe tournées vers cette époque révèlent un jeune au sens de l’humour crétin (l’une d’entre elles, une scène de six minutes montrant une marionnette-chaussette qui annonce la météo, lui valut un F, note-t-il, parce qu’elle manquait de «données exactes» sur la météo) et entretenant de bonnes relations avec ses camarades —ou, en tout cas, avec ceux qui jouaient à ses côtés dans une «telenovela» cinglée de 11 minutes qui se termine sur un Swartz coiffé d’un sombrero, abattu par un garçon en maillot de foot violet («Ay, yi, mi muerto! Mato! Mato!», hurle-t-il, avec une passion inversement proportionnelle à son niveau de grammaire).
Le mécontentement de Swartz avait moins de rapport avec ses pairs qu’avec le concept plus large d’éducation organisée. Au départ, il était déterminé à réformer les choses de l’intérieur et son blog débordait d’optimisme sur les écoles nomades et les professeurs stimulants et sur une «grande réunion» lors de laquelle Swartz soumit à Ryshke, le directeur des grandes classes, des livres sur la réforme de l’éducation.
Une vie marquée par l’impatience
Son ardeur réformatrice finit par se calmer, et Swartz se concentra sur l’élaboration d’une stratégie de sortie. Ce fut le début de toute une vie marquée par l’impatience devant des situations désagréables. Au lieu de tenter de s’adapter à ce qu’il considérait comme des institution rigides et cassées, Swartz essayait de les faire s’adapter à lui. Et quand elles ne changeaient pas, il partait.
«Nous avons évoqué la possibilité d’aller à la fac plus tôt, d’opter pour le chemin du petit génie, mais je crois que suivre des cours d’anglais et d’algèbre ne l’intéressait pas», explique Ryshke:
Swartz a raconté sur son blog comment il avait terminé sa première année de lycée en faisant part de ses doléances lors d’une réunion de l’école:
Ni Robert Ryshke, ni aucune autre source du NSCDS ne s’en rappelle («Cela ressemblerait assez à Aaron de faire ça», reconnaît Ryshke). Quoi qu’il en soit, cette histoire reflète sa conviction que le lycée était un ennemi malveillant qu’il fallait vaincre.
«L'Internet a été fondé sur le libre accès»
Peu importait ce que les autres pensaient ou disaient, Swartz savait que sa décision était la bonne («Il affirmait avoir tenté de convaincre nombre de ses camarades d’abandonner l’école avec lui, et n’avoir eu aucun succès», raconte Taren Stinebrickner-Kauffman, rapportant les souvenirs de Swartz de cette époque. «Je ne peux qu’imaginer ce que pouvaient penser leurs parents.»). À l’été 2001, à 14 ans, Swartz quitta North Shore Country Day.
Tandis qu’il luttait pour se frayer un chemin dans la vie réelle, la vie en ligne de Swartz prospérait. Il accompagna son père dans un voyage d’affaires au MIT, où il assista à une conférence donnée par Philip Greenspun, professeur et défenseur des logiciels open source.
Greenspun possédait une entreprise, ArsDigita, qui sponsorisait un concours où des adolescents rivalisaient pour construire des sites utiles et non-commerciaux. Swartz entra dans la compétition en 2000 et figura parmi les finalistes pour sa contribution, The Info Network, une encyclopédie à laquelle tout le monde pouvait participer (c’était des mois avant le lancement de Wikipédia, en 2001).
«Procurer de “vraies informations” aux gens sur le World Wide Web, c’est le boulot d’Aaron Swartz, 13 ans. Il est fatigué de toutes les bannières de publicité, du sponsoring et de toute la “camelote” diverse et variée qui polluent les écrans», expliquait le Chicago Tribune dans un article de juin 2000 sur la participation de Swartz au concours.
«L’Internet n’a pas été fait pour ça. Il a été fondé sur le libre accès et la liberté, pas sur la publicité», confia Swartz au Tribune. Peu importait que les amis et la famille de Swartz aient été les seuls à utiliser The Info Network, ou que, allez savoir pourquoi, les entrées les mieux évaluées concernaient des joueurs de réserve des Chicago Cubs, comme Shane Andrews et Jeff Reed.
Très jeune, il avait découvert sa passion: trouver des informations, les organiser et les partager avec toutes les personnes susceptibles d’être intéressées.
Un réseau d'amis créé via Internet
Le Web permit également à Swartz d’avoir une vie sociale épanouie. «J’ai développé mes relations les plus importantes en ligne», écrivit-il à 14 ans, en avril 2001:
Il se connectait à son réseau en ligne via son blog, lancé début 2002 et qui ne tarda pas à devenir populaire parmi les mordus des nouvelles technologies. Même adolescent, Swartz avait une plume alerte et claire, prolifique et aux opinions bien arrêtées.
S’il paraissait souvent agressif ou dédaigneux, c’était sans doute parce qu’il essayait de compenser son jeune âge —ce dont il fut très conscient très tôt et dont il ne parlait pas. Wes Felter, chercheur et blogueur qui le connaissait à l’époque, raconte que Swartz rejetait les «arguments insignifiants» selon lesquels il n’était qu’un gamin et n’avait pas assez d’expérience pour afficher ses opinions:
«Je trouve que ce que vous faites est plutôt cool»
Beaucoup des correspondants de Swartz étaient impliqués dans le mouvement du Web sémantique, initiative visant à structurer le monde en ligne pour que les ordinateurs le décomposent plus facilement. Le boom des .com avait provoqué très rapidement une immense croissance et le Web ressemblait alors à une ville dépourvue de plan d’occupation des sols.
Le World Wide Web Consortium (W3C), organisation créée par l’inventeur du World Wide Web Tim Berners-Lee en 1994, milita pour une standardisation d’Internet —pour garantir que les pages s’afficheraient correctement et que la transmission et la récupération des informations gagnerait en qualité, pas l’inverse.
Le W3C travailla beaucoup par le biais de mailing-lists. Dans ces chaînes de mails, les participants résolvaient des problèmes de code, débattaient sur la question des standards et jetaient les fondations de l’avenir d’Internet.
Bien que les listes aient été principalement utilisées par des chercheurs et des programmeurs professionnels, tout le monde pouvait participer. «Il existait une tradition de méritocratie née dès le début d’Internet», explique Brewster Kahle, fondateur d’Internet Archive. «Ce qui fait que si vous avez du talent et que vous apportez votre aide, vous devenez un membre de première classe de n’importe quel groupe auquel vous voulez appartenir.»
Aaron Swartz, 13 ans à l’époque, posta son premier message sur le groupe rdfweb-dev le 21 août 2000:
Un gamin obsédé par les rails, pas par les trains
Beaucoup de gamins sont obsédés par les trains. Beaucoup moins le sont par les rails, les aiguillages et les signaux. Mais déjà à l’époque, Swartz était fasciné par les insuffisances originelles qui empêchaient de grands systèmes de fonctionner au maximum de leurs capacités.
C’était précisément le genre de choses qui préoccupaient les chercheurs de W3C. Swartz leur correspondait parfaitement.
Vers la même époque, il rejoignit également un groupe de travail dédié au RSS. Cette technologie de lecture d’actualités avait été développée par Netscape à l’origine, mais l’entreprise ayant perdu tout intérêt dans son maintien, des bidouilleurs en ligne avaient repris le flambeau.
En 2000, deux groupes de programmeurs voulaient emmener le RSS dans deux directions différentes. L’un d’entre eux était un groupe affilié au Web sémantique, qui proposait de réécrire le standard afin d’y inclure des métadonnées plus faciles à décomposer. Swartz rejoignit leurs rangs et contribua à l’élaboration d’un standard appelé RSS 1.0.
De nombreuses nécrologies ont affirmé que Swartz avait créé ou co-créé le RSS. Ce n’est pas vrai: il appartenait à un groupe dissident qui avait créé une version du RSS utilisée par relativement peu de gens.
Ce qui n’empêchait pas ses contributions d’être très réelles et valorisées, et ses collaborateurs étaient toujours surpris lorsqu’ils découvraient que Swartz était un adolescent.
«Au départ, vous rencontrez ces gens par écrit», se souvient Dan Connolly, créateur de logiciels affilié 15 ans à W3C. «Le type écrit des codes, fait des commentaires intelligents; en ce qui vous concerne, c’est votre égal. Et puis vous découvrez qu’il n’a que 14 ans, et vous tombez des nues.»
En décembre 2001, Aaron Swartz raconta sur son blog un rêve peu ordinaire:
Qu’il l’ait su ou pas, ce monde de rêve qu’il décrivait existait réellement, les toboggans aquatiques en moins, et Swartz allait devenir l’un de ses plus importants héritiers.
Un rêve devenu réalité
Il existe une photo d’Aaron Swartz adolescent assis sur un banc, vêtu d’un t-shirt «GNU’s Not Unix», en train de parler avec le professeur de droit Lawrence Lessig. C’est un peu une photo de famille, le cliché de deux générations de cyber-idéalistes.
Aaron Swartz et Lawrence Lessig / Rich Gibson via Wikimedia Commons. Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Le t-shirt de Swartz vient d’un groupe appelé Free Software Foundation et le slogan fait référence au système d’exploitation créé par la fondation. GNU/Linux (GNU pour «GNU’s Not Unix») est une alternative gratuite d’origine communautaire au système d’exploitation Unix, conçue dans les années 1980 par un développeur de logiciel du nom de Richard Stallman.
Dans les années 1970, Stallman était l’un des nombreux programmeurs affilié à l’Artificial Intelligence Lab du MIT. Comme le raconte Steven Levy dans Hackers, son récit des origines de l’informatique moderne, l’AI Lab était une sorte d’utopie de la programmation qui attirait les enthousiastes de l’informatique de tous les horizons —une Brook Farm de l’ère numérique.
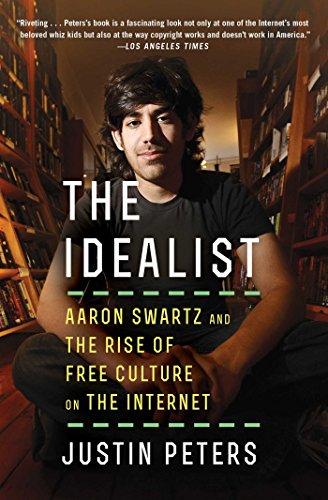
C’était un système horizontal et non-hiérarchique, où l’on vous jugeait sur l’envergure de votre travail, pas sur votre âge, votre statut, votre titre ou vos diplômes.
«Il y avait des gens qui ne faisaient que passer, qui n’étaient ni des étudiants, ni des membres du personnel. Ils passaient juste par là, et ils nous aidaient», raconte Brewster Kahle, membre de l’AI Lab au début des années 1980. «Et cette ouverture était merveilleuse et très créative.»
Inspiré par «le dernier des véritables hackers»
Stallman et ses co-hackers écrivaient et entretenaient le logiciel essentiel aux recherches du labo. Mais sous de nombreux aspects, c’était moins un lieu de travail qu’un lieu d’éveil politique.
«Les hackers parlaient ouvertement de changer le monde grâce aux logiciels, et Stallman acquit le dédain instinctif du hacker envers tout obstacle empêchant d’atteindre cette noble cause», écrit Sam Williams dans Free as in Freedom, sa biographie de Stallman de 2002:
Steven Levy qualifie Stallman de «dernier des véritables hackers» —de tous les affiliés à l’AI Lab, il était celui qui avait organisé le plus fiévreusement sa vie autour de l’éthique du groupe. Si les autres se sont dirigés vers le secteur privé et ont parfois fait fortune, Stallman n’a jamais perdu son idéalisme radical (sous cet angle, c’est un peu le Ian MacKaye de l’informatique).
Stallman, qui a conservé un bureau dans ce que le MIT qualifie désormais de Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, fonda la Free Software Foundation au milieu des années 80, qu’il préside encore aujourd’hui. Cette organisation se consacre à l’idée que les logiciels libres («free [libres] comme dans liberté, pas free [gratuit] comme dans bière») sont un impératif moral.
Swartz ne connaissait pas personnellement Stallman, mais les principes du programmeur l’inspiraient, ainsi que le fait qu’il ait chapeauté un organisme qui prenait l’éthique au sérieux tout en étant efficace.
En 2002, il assista à une intervention de Stallman lors de la O’Reilly Open Source Convention. «La chose la plus intéressante que j’aie apprise … c’est le côté très humain de Stallman», écrivit-il plus tard:
«Un ado de 14 ans pour le projet»
À la même conférence en 2002, c’est Lawrence Lessig —le Richard Stallman du mouvement des droits d’auteur— qui fit le discours principal.
Lessig, à Stanford à l’époque et aujourd’hui à Harvard, a beaucoup écrit sur les injustices de la loi américaine sur le copyright. Les entreprises font pression sur le Congrès pour qu’il continue d’étendre la portée et la durée des protections des droits d’auteur, estime-t-il, ce qui maintient les documents hors du domaine public et étouffe l’innovation créée grâce au partage et au remixage. Dans l’introduction de son ouvrage de 2004 Free Culture, Lessig note que «tous les aperçus théoriques développés ici l’ont été par Stallman il y a des décennies».
En 2001, Lessig inventa sa propre variation de la Free Software Foundation de Stallman, organisation qu’il appela Creative Commons. Il voulait réformer les lois sur le copyright en donnant aux créateurs de contenus davantage de possibilités de diffuser leurs travaux —en leur permettant de spécifier, par exemple, qu’une photo était utilisable libre de droits ou qu’on pouvait l’adapter sans avoir à en demander l’autorisation.
Lessig engagea Lisa Rein, programmeuse et archiviste, pour l’aider à construire le site Internet de Creative Commons. Elle suggéra à son tour que Swartz, qu’elle avait rencontré dans la communauté du Web sémantique, pourrait superviser la mise en place des métadonnées du site.
«Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu’il n’a pas été difficile à l’époque de convaincre ces gens qu’il me fallait un ado de 14 ans pour le projet», se souvient-elle. «Politiquement, cela m’a coûté cher à l’époque. Jusqu’à ce qu’ils le rencontrent. Personne n’y comprenait rien, jusqu’à ce qu’ils le rencontrent.»
Ben Adida, un des participants au projet, se souvient de Swartz comme d’un élément actif et important, «un créateur de logiciel extrêmement talentueux qui se trouve avoir 14 ans et porter un t-shirt trois fois trop grand pour lui».
Ils travaillèrent étroitement tous les deux sur la mise en œuvre des métadonnées, et pas toujours en parfaite harmonie. «Il mettait la barre incroyablement haut, et nous n’étions pas à la hauteur», se rappelle Adida. «Il était très critique sur mon travail, et le disait publiquement. Il était assez dur avec moi».
«Soit un super-héros, soit un super-méchant»
Swartz était très exigeant avec son entourage, mais il lui tenait également beaucoup à cœur de nouer des liens avec ses nouveaux collègues.
En avril 2002, il prit l’avion pour San Francisco pour assister à un événement Creative Commons et Lisa Rein l’accompagna pour visiter la ville. Elle estima qu’elle avait le devoir de lui faire rencontrer les bonnes personnes. «En quelque sorte, j’avais décidé qu’il deviendrait soit un super-héros, soit un super-méchant», explique-t-elle.
Rein lui fit rencontrer tous les gens qu’elle connaissait dans le monde de l’open-access, qui allaient devenir ses amis et ses collaborateurs. L’expérience ouvrit les yeux de Swartz et lui fit comprendre qu’il n’était pas tout seul.
«Je sais qu’Aaron a passé une grande partie du début de sa vie à se battre avec le fait que son intérêt et sa curiosité étaient éveillés par un tas de choses qui n’intéressaient pas les autres», explique Seth Schoen, technologue à l’Electronic Frontier Foundation. Ce dernier rencontra Swartz en 2002, alors qu’il avait 23 ans et que son futur ami en avait 14:
City museum of St Louis / Quinn Norton via Flickr CC License By
«Moins mûr que les autres, mais pas de beaucoup»
Swartz avait trouvé les siens, en chair et en os, pas seulement sous forme de noms sur la ligne des destinataires d’une liste de diffusion. De 2002 à 2004, il passa énormément de temps en leur compagnie, spectateur et intervenant de nombreuses conférences sur les technologies émergentes et les problèmes technologiques (à la maison, il se disputait énormément avec ses frères et ses parents pour savoir qui avait le droit d'utiliser le Segway familial).
En dépit de sa jeunesse, Swartz n’était pas traité comme une adorable mascotte du monde de la technologie. «Bon d’accord, socialement, il y avait pas mal de nerds», se souvient Wes Felter:
Les journées se passaient à écouter des conférences, et les activités d’après-dîner pouvaient inclure «une expédition à l’Apple Store pour aller voir l’iMac tout nouveau à l’époque, celui qui ressemblait à une tablette attachée à un globe», comme le raconte Joey «Accordion Guy» deVilla dans des récent souvenirs publiés en ligne.
Stanford, un nouvel endroit à réparer
En 2004, Swartz avait contribué au lancement de Creative Commons, travaillé sur le standard RSS 1.0, créé et entretenu un blog populaire et mis la main à un nombre incalculable d’autres projets, petits et grands.
Mais il était aussi sur le point d’avoir 18 ans, et malgré sa méfiance à l’égard de la scolarité organisée, on attendait de lui —ses parents et à peu près tout le reste du monde— qu’il aille à l’université. À l’été 2004, il s’inscrivit à la Stanford University.
Pour Swartz, Stanford l’éloignait du monde rêvé de Creative Commons et le faisait revenir vers tout ce qu’il avait détesté au lycée. Une semaine après son arrivée à Palo Alto, il bloguait que «l’exceptionnelle intelligence de la plupart des étudiants (et des professeurs) de Stanford ne [l'avait] pas particulièrement frappé.»
L’université n’était pas un monde intellectuel idéal —c’était juste un nouvel endroit à réparer. «Si je voulais lancer une université plus efficace, ce serait assez simple», écrivit-il lors de son troisième jour à Stanford:
Swartz vivait à Roble Hall, dans un appartement avec trois autres personnes. «C’était un gars assez introverti, j’étais un gars assez introverti», se souvient son colocataire, Rondy Lazaro. «Quelques personnes de son bâtiment étaient au courant de son travail de programmation. Pour eux il était LE Aaron Swartz.»
Pour la plupart des gens, cependant, il n’était que le type au bout du couloir avec le vélo couché et le meuble-classeur.
Swartz étudia la sociologie. «L’autre soir, quand [nom effacé] m’a demandé pourquoi j’étais passé de l’informatique à la sociologie, j’ai répondu que l’informatique c’était compliqué et que je n’étais vraiment pas bon, ce qui n’est pas vrai du tout en réalité», écrivit-il sur son blog. «La véritable raison, c’est que je veux sauver le monde.»
Asleep in Midpage / Quinn Norton via Flickr CC License By
Dans plusieurs posts, il raconte son expérience à Stanford comme un anthropologue prend des notes de terrain. Il écrivit sur la pensée de groupe en campus et critiquait ses cours. De temps en temps, sa solitude perçait la carapace:
Swartz n’était peut-être pas le narrateur le plus objectif de son expérience à l’université. Beaucoup de ceux qui le connurent à Stanford disent que ce n’était pas un solitaire absolu et qu’il était toujours prêt à participer à la conversation.
Des difficultés à nouer des liens sociaux
Mais son blog —qu’il avait choisi de ne pas partager avec les autres étudiants— n’est pas l’œuvre de quelqu’un qui s’éclate dans ses premières années de fac. Ses cours n’étaient pas assez intéressants ou motivants et il se languissait pour celle qu'il surnommait TGIQ («The Girl in Question», «la fille en question»), «qui réussissait toujours à «disparaître avant qu'[il] ne puisse la rattraper».
Au lieu de papoter avec ses camarades de première année, il hantait les bureaux de professeurs comme Lessig. «C’est chouette, sauf que ça m’ennuie de les ennuyer», écrivit-il.
Le pire de tout était que ses camarades ne pensaient pas comme lui. Avant de rencontrer l’équipe de Creative Commons, il avait eu du mal à trouver des gens avec qui il pouvait nouer un lien. «Je me souviens qu’il espérait vraiment que cela changerait en partant pour Stanford», raconte Seth Schoen:
Leur curiosité ne se manifestait probablement pas de la même manière que la sienne —ils prenaient Stanford comme elle était et en tiraient le meilleur parti possible, plutôt que de remettre en question tout ce que l’université représentait.
Pourtant, il essaya de faire fonctionner les choses. En 2005, il participa au lancement de la Roosevelt Institute Campus Initiative, groupe incitant les étudiants à s’engager en politique.
Mais il se désengagea progressivement de l’école, passant de plus en plus de temps hors du campus avec des gens impliqués dans l’activisme politique et la liberté des données. En outre, il complétait ses études en lisant beaucoup. «Il lisait davantage de fictions quand il était un génie informatique de 18 ans que je n’en lis aujourd’hui dans le cadre de mes études supérieures en création littéraire», se souvient Kat Lewin, l’une de ses colocataires.
Deux livres changent sa vision du monde
L’été avant qu’il n’arrive à Stanford, Swartz lut deux livres qui changèrent sa vision du monde.
Moral Mazes, qu’il qualifierait plus tard de son livre préféré absolu, est une étude ethnographique de la culture managériale de l’entreprise américaine. Robert Jackall s’y penche sur la logique institutionnelle du monde de l’entreprise et explique comment la dilution des responsabilités et l’étroitesse organisationnelle créent une culture qui récompense les managers quand ils font les mauvais choix.
Dans Comprendre le pouvoir, qui développe le même genre de point de vue, le linguiste et activiste politique Noam Chomsky explique comment les structures du pouvoir poussent des gens bien à faire des choses horribles.
Ces deux livres sont des mises en accusation de la bureaucratie —de la façon dont les organisations géantes nuisent aux corps étrangers entrant en contact avec elles et à ses membres qui refusent de jouer le jeu. Pour quelqu’un comme Swartz, prédisposé à résister à l’idée d’être un engrenage dans une machine, c’était la justification intellectuelle dont il avait besoin pour plaquer le système industriel d’éducation. Comme la North Shore Country Day School avant elle, Stanford n’eut jamais la moindre chance.
Fin de l’épisode fac
Swartz sauta sur la première occasion venue de plier bagages. Celle-ci prit la forme de l’essayiste et entrepreneur Paul Graham, fondateur de l’entreprise Y Combinator en 2005. Graham, qui devint riche à millions en vendant son entreprise Viaweb à Yahoo!, pensait que des talents aussi brillants et insatiables que Swartz devaient quitter l’école et commencer à construire des choses.
Il invita des entrepreneurs naissants à lui envoyer des propositions de start-ups dans le domaine des nouvelles technologies; il choisissait celles qui lui plaisaient et emmenait leurs créateurs à Cambridge, dans le Massachussetts, pour les mettre sur les rails l’espace d’un été.
Swartz proposa à Graham une chose appelée Infogami, une plateforme conçue pour aider ses utilisateurs à construire des sites Internet structurés, riches en contenus et à l’architecture dirigée par les données. C’était une progression conceptuelle logique après les projets de Web sémantique dans lesquels il avait baigné et elle devint l’une des huit entreprises à être financée cette année-là.
Peu de temps après le départ de Harvard de Mark Zuckerberg, direction la culture start-up de Palo Alto, Swartz faisait le chemin inverse, abandonnant la Californie après seulement une année pour monter une start-up sur la côte Est. Fin de l’épisode fac.
Infogami fit un bide —il n’y a pas d’autre façon de le dire. Swartz n’avait pas l’expérience nécessaire pour construire un projet aussi ambitieux à partir de rien. Il eut du mal à attirer des investisseurs et à verbaliser le problème spécifique qu’Infogami était censé résoudre.
En outre, Swartz et son colocataire/collaborateur, un jeune programmeur danois appelé Simon Carstensen, ne formaient pas un super couple de partenaires. Quand Carstensen arriva dans la petite chambre étouffante du MIT qu’ils allaient partager pour l’été, c’était la première fois que les deux hommes se rencontraient. «Je me rappelle être assis dans ce dortoir, en train de coder, et d’avoir eu très chaud», raconte Carstensen.
Swartz réécrivit une grande partie du code de Carstensen, et à la fin de l’été, le Danois retourna en Europe et ne retravailla plus sur Infogami. Swartz resta à Boston, mais sa start-up commença à lui faire perdre patience.
D’Infogami à Reddit
Il était seul, habitait chez Paul Graham, et avait le moral à zéro:
À peu près à la même époque, deux autres participants à Y Combinator avaient désespérément besoin d’aide pour leur propre start-up, un site communautaire appelé Reddit. La solution de Graham fut simple: Infogami allait fusionner avec Reddit, créant une nouvelle société-mère appelée Not a Bug. Swartz s’installa à Davis Square dans l’appartement d’Alexis Ohanian et Steve Huffman et se mit au travail.
Dr miyagi when asked if he could break through a stack of bricks responded asking why he should know how to do that… https://t.co/07n0xj79kL
— Ekerombeta n'ekerongo Wed Sep 16 03:41:22 +0000 2020
L’histoire du passage de Swartz à Reddit est compliquée. Il ne fut pas impliqué dans la conceptualisation de Reddit; le projet était déjà sur pied lorsqu’il monta à bord. Si Ohanian et Huffman ne le considéraient pas comme un cofondateur, Swartz utilisait tout de même souvent le mot.
Ce que l’on peut dire, c’est que Swartz était malheureux chez Reddit, et que l’équipe de Reddit n’était pas non plus contente de lui.
Le projet de départ était que Huffman aide Swartz pour Infogami tandis que Swartz l’aiderait pour Reddit, et que les deux projets partiraient d’un programme commun qu’ils construiraient à deux.
Huffman était très enthousiaste à l’idée de travailler avec Swartz, qu’il considérait comme un programmeur de talent. «Il y a eu un moment, les deux premiers mois, où on s’est dit: OK, on va lancer ce nouveau truc et ça va être plus gros que Reddit, plus gros qu’Infogami», raconte Huffman. «Et il est devenu assez clair au bout de quelques mois que cela n’allait pas se passer comme ça.»
Le lancement d’Infogami ne se passait pas bien et Swartz se démoralisait. «Il en avait marre de travailler sur Reddit, et moi je n’ai jamais voulu travailler sur Infogami», rapporte Huffman. «C’était le début de la fin.»
Quête d’épanouissement personnel
Pendant des mois, Swartz ne travailla pas sur Reddit, mais continua d’habiter avec Huffman et Ohanian. Son esprit changeant se concentrait sur d’autres choses, notamment une candidature ratée pour un poste au conseil d’administration de la Wikimedia Foundation.
Et, comme à l’époque de ses coups de blues au lycée ou à la fac, il déchargeait ses frustrations sur son blog. «Je ne veux pas être programmeur», écrivit-il en mai 2006, à 19 ans:
La quête d’épanouissement personnel de Swartz engendrait un environnement de travail désagréable.
Huffman étant le seul ingénieur à plein temps de Reddit, le succès du site n’était pas assuré. Pourtant, en octobre 2006, seize mois après la fondation de Reddit, Condé Nast acheta la société pour une somme non divulguée, quelque part entre 10 et 20 millions de dollars.
Une partie de cet argent revint à Graham et une autre à Chris Slowe, programmeur à temps partiel qui avait des parts dans l’entreprise. Swartz, Huffman et Ohanian se partagèrent le reste (Swartz donna une partie de sa part à Simon Carstensen, pour le récompenser de son travail sur Infogami.)
L’accord stipulait que l’équipe de Reddit déménagerait de Boston à San Francisco; il n’était pas prévu que Swartz, ouvertement malheureux de sa situation, les accompagne. Mais pour une raison quelconque —masochisme, sens du devoir, ou conviction qu’un changement de paysage pourrait améliorer les choses—, il décida de repartir à l’Ouest.
L’équipe de Reddit travaillait dans le bureau de Wired, dans un coin dégagé spécialement pour eux. Cet environnement physique ressemblait beaucoup au «loft au design moderne» idéalisé dont un Swartz adolescent avait rêvé en 2001 —un grand espace ouvert avec un chef personnel qui faisait le petit-déjeuner pour tout le monde.
Mais comme on pouvait le prévoir, Swartz fut malheureux, absolument inadapté à la vie en entreprise. Chaque réunion, chaque banalité devait représenter pour lui un labyrinthe moral. Il arrêta de venir au bureau, écrivait des posts de blog critiquant ses collègues, partait pour des voyages impromptus en Europe et travaillait très peu.
Une fois de plus, il tentait de se détacher d’un environnement qui n’avait pas été à la hauteur de ses attentes. Mais cette fois, il ne put partir en dictant ses propres conditions. Moins de trois mois après la matérialisation de la vente à Condé Nast, Ohanian et Huffman lui demandèrent de s’en aller.
Un billet de blog sur un suicide
À peu près à l’époque où il fut renvoyé de Reddit, Swartz écrivit une longue histoire sur son blog sur un homme qui s’était affamé avant de se suicider:
«Alex» était au départ baptisé «Aaron» (Swartz supprima le post pendant un moment, puis changea le nom du personnage lorsqu’il le remit en ligne).
Alexis Ohanian, dont la petite amie de l’époque avait tenté de se suicider moins d’un an auparavant, appela la police et s’assura qu’elle allait vérifier que Swartz allait bien, ce qui était le cas. Plus tard, il expliqua que ce post de blog était un essai de fiction mal compris:
Impossible de dire si ce post était une histoire mélodramatique, un appel au secours ou une prémonition morbide. À l’époque en tout cas, il servit de fin dramatique et définitive à un chapitre peu satisfaisant de sa vie. Swartz avait 20 ans et se retrouvait sans travail. Mais au moins, il sentait qu’il avait de nouveau le contrôle de sa vie.
Reddit, «juste une liste de liens»
Tôt ou tard, tout vrai croyant a l’occasion de renier ses principes —de mettre l’argent ou le confort avant ce qu’il revendique être le plus important à ses yeux. À la fin des années 1970, l’AI Lab du MIT se désintégrait.
Plusieurs programmeurs étaient partis pour former leur propre société, Symbolics, qui construisait et vendait des Machines Lisp et le logiciel pour les faire fonctionner. Il s’agissait du même langage informatique que, jusqu’à cette époque, les hackers de l’AI Lab développaient gratuitement.
Stallman le vécut comme une gigantesque trahison et se retrancha dans le dernier bastion d’idéalisme d’un environnement où il s’épanouissait jadis.
Le dernier des vrais hackers accomplit de véritables prouesses de programmation pour égaler —tout seul— chaque mise à jour logicielle de Symbolics, tout en s’assurant que la version gratuite serait aussi bonne que la payante. Peu de temps après, Stallman quitta l’AI Lab pour lancer la Free Software Foundation et faire de son idéalisme l’œuvre de toute une vie.
La séparation de Swartz et de Reddit, si elle ne fut pas aussi longue et ouvertement antagoniste que la bataille Stallman/Symbolics, fut tout aussi idéologique. Bien qu’il ne l’ait pas verbalisé à l’époque, il est clair avec le recul que Swartz détestait la sensation de faire quelque chose pour de l’argent. Après la vente à Condé Nast, il décrivit son sentiment de culpabilité d’avoir reçu autant d’argent pour un projet qui à ses yeux était tellement insignifiant:
Au carrefour des données et de l’autorité
Quitter Reddit poussa Swartz à réexaminer sa vie. Tout projet unique pouvait s’avérer une tâche accablante, une corvée ou un projet chiantissime. La solution à ce problème était de s'engager dans «tous les projets intéressants qui se présentaient».
Il travailla sur une autre start-up, Jottit, avec son ancien partenaire d’Infogami Simon Carstensen. Il donna aussi un coup de main au lancement de l’Open Library de Brewster Kahle, d’Internet Archive, ambitieux effort pour créer une page de description de chaque livre existant.
Les projets qui l’intéressaient étaient de plus en plus souvent au carrefour des données et de l’autorité. Swartz avait grandi dans une famille où l’activisme était érigé en vertu et ses premiers travaux avec Creative Commons lui avaient donné une cause bien à lui.
En octobre 2002, à 15 ans, il s'était rendu à la Cour Suprême, invité par Lawrence Lessig. Le professeur de droit défendait le plaignant dans Eldred v. Ashcroft, affaire cruciale dans le domaine des droits d’auteur modernes. Lessig plaida que le tribunal devait annuler le Sonny Bono Copyright Term Extension Act, qui étendait la protection des droits d’auteur de façon significative. Il perdit, mais l’expérience fut formatrice pour Swartz —qui fut un ardent réformateur des lois sur les droits d’auteur tout le reste de sa vie.
Dans les années qui suivirent, à la fois Lessig et Swartz devinrent de plus en plus ouvertement politiques. En 2008, le professeur de droit participa à la fondation d’une organisation appelée Change Congress, qui incitait les citoyens à faire ce que son nom indiquait.
Swartz s’y impliqua avec ardeur et rejoignit le conseil d'administration du groupe. Ce projet déclencha chez lui un intérêt pour la politique électorale. Swartz contacta des amis à Washington, les sondant sur le fonctionnement du système et leur demandant les moyens de l’améliorer.
«Quand vous parlez au gens de la Silicon Valley, ils vous disent souvent que les politiciens sont stupides», souligne Matt Stoller, l’une des personnes contactées par Swartz:
Un programmeur à valeur politique
Swartz ne tarda pas à réaliser que son talent pour accéder aux informations et les synthétiser pouvait avoir une valeur politique —qu’il était meilleur programmeur et collecteur de données que la plupart des autres activistes et que son activisme était plus ardent que celui de la plupart des as des logiciels.
Swartz contribua à fonder un groupe, le Progressive Change Campaign Committee, consacré à l’élection de candidats progressistes au Congrès. Il obtint une bourse Sunlight Network pour lancer un site appelé Watchdog.net, qui rassemblait les informations sur les documents électoraux et les financements de campagne et donnait à ses utilisateurs des outils pour manipuler et présenter ces données eux-mêmes.
Mais Swartz ne tarda pas à poser les yeux sur un plus gros poisson: PACER, l’entrepôt électronique des dossiers judiciaires fédéraux. Les contenus de PACER sont publics et n’importe qui peut y accéder via le Web pour une petite somme (10 cents la page aujourd’hui).
Pour Carl Malamud, activiste prônant la transparence, ces documents n'auraient pas dû coûter un seul centime, car il s’agissait de produits gouvernementaux et de ce fait, non soumis aux droits d’auteur.
Dinner at Willow Cottage (some piracy) / Quinn Norton via Flickr CC License By
En 2008, Malamud lança un appel à ceux qui pensaient comme lui pour qu’ils collectent un maximum de documents dans PACER pendant une période d’essai au cours de laquelle les documents seraient téléchargeables gratuitement dans certaines bibliothèques.
Cet appel à l’action trouva tout naturellement un écho chez Swartz, ennemi déclaré des restrictions des droits d’auteurs et partisan de l’open data. En septembre 2008, il se rendit dans une bibliothèque de Chicago et installa un script Perl qui extrayait un document de PACER toutes les trois secondes.
Avant que la bibliothèque ne s’en rende compte et ne l’arrête, il eut le temps de télécharger 19.856.160 pages, qu’il donna au site prônant la transparence de Malamud, Public.Resource.Org.
Pour Swartz, la décision d’installer ce script Perl représenta un changement subtil mais spectaculaire d’idéologie et de méthode. Il avait toujours été convaincu que les informations voulaient être libres. Et il venait de jouer le rôle de libérateur. Il avait également choisi de se moquer du gouvernement fédéral, bernant sérieusement un système rétif au changement.
Bien qu’il n’ait rien eu d’illégal, cet exploit attira l’attention du FBI sur Swartz et Malamud. Swartz se procura plus tard son dossier au FBI, qui indiquait que des agents avaient surveillé la maison familiale à Highland Park.
Ce dossier du FBI, raconta-t-il, était «véritablement délicieux». À l’époque, tout cela semblait drôle —que des agents fédéraux puissent être aussi contrariés par un fait si dérisoire.
Mais Malamud pense aujourd’hui que les téléchargements de PACER ont joué un rôle dans la détermination ultérieure du gouvernement lors des poursuites dans l’affaire JSTOR. À leurs yeux, Swartz était un récidiviste, un Robin des Bois des données. Ce n’était pas rien.
En 2008, Swartz commença à se lasser de San Francisco. Il y était depuis 18 mois et trouvait de plus en plus que la ville était superficielle. «Quand je vais au café ou au restaurant je n’arrive pas à éviter les gens qui parlent de répartition de charge ou de bases de données», écrivit-il:
À la fin du printemps, Swartz quitta la ville pour de bon et retourna à Cambridge, qu’il décrivit comme «l’unique endroit où je me sois jamais senti chez moi.»
Il passait le plus clair de son temps à travailler dans un bâtiment branlant de Harvard Square appelé le Democracy Center, qui abritait plusieurs activistes progressistes. Son bureau, à l’étage, arborait un balcon cassé et un trou dans le mur, ce qui signifiait qu'il pouvait entendre tout ce qui se passait à côté.
Son voisin était Ben Wikler, organisateur politique et ancien collaborateur de The Onion, qui travaillait pour une organisation activiste mondiale appelée Avaaz. Ils devinrent amis.
«Je connaissais tous ces gens qui faisaient de l’activisme et de l’organisation en ligne, mais si je lisais constamment des blogs sur les nouvelles technologies, je n’y connaissais personne. Et Aaron connaissait tous les blogueurs tech», se rappelle Wikler. «Nous étions tous les deux le ticket d’entrée dans le monde de l’autre.»
De PACER à JSTOR
L’engagement politique de Swartz prit de l’ampleur, et il assista à des réunions d’activistes en ligne organisées par Wikler au-dessus du Hong-Kong Restaurant sur Harvard Square. Il commença à faire de drôles d’expériences avec ses horaires de sommeil, décidant qu’il commencerait à se réveiller à 5 heures du matin (l’expérience fut de courte durée).
Il devint membre du Safra Center for Ethics de Harvard, étudiant la manière dont l’argent influence la politique, les médias et la recherche universitaire et industrielle. Et, le 24 septembre 2010, il s’acheta un ordinateur portable Acer, l’apporta au MIT, et se prépara à télécharger des documents depuis la base de données de publications universitaires JSTOR.
Son projet concernant le JSTOR différait de ses frasques avec PACER à plusieurs titres. Tout d’abord, le JSTOR n’est pas une réserve de documents gouvernementaux non-soumis aux droits d’auteurs.
Si ses abonnés peuvent accéder gratuitement à son contenu, cela reste un service payant —de grandes institutions de recherche vont jusqu’à allonger 50.000 dollars par an pour y avoir accès— conservant des articles de revues qui pour la plupart sont soumises aux droits d’auteur.
Ensuite, Swartz n’était pas poussé par un appel à l’action et à la libération de l’information aussi facilement identifiable que l’incitation de Carl Malamud pour PACER.
Il y avait eu un précédent potentiel: quelques années plus tôt, il avait collaboré avec une étudiante en droit de Stanford appelée Shireen Barday sur un projet impliquant le téléchargement de presque 450.000 articles de la base de données Westlaw pour les analyser afin de voir qui, exactement, finançait les recherches dans le domaine du droit.
S’il est possible que Swartz ait eu l’intention de poster son cache JSTOR sur le Web, il est également plausible qu’il envisageait seulement d’utiliser les articles dans le cadre de recherches comme dans le projet avec Shireen Barday. On ne peut avoir de certitude.
Enfin, Swartz semble avoir tenté de cacher son lien avec les téléchargements du JSTOR —décision compréhensible, étant donné l’intérêt du FBI pour son projet PACER. C’est probablement la raison pour laquelle, au lieu de simplement utiliser le réseau de Harvard (où il aurait eu accès au JSTOR), il choisit d’aller au MIT.
Une fois sur place, il se connecta au réseau sans fil du MIT comme invité et exécuta un script lui permettant de récupérer une foule d’articles. Si les utilisateurs autorisés peuvent théoriquement télécharger tout ce qu’ils veulent gratuitement depuis le JSTOR, ses conditions d’utilisation interdisent le recours à des programmes encourageant le téléchargement de masse.
Swartz devait savoir que son script allait attirer l’attention du JSTOR et faire naître le soupçon qu’il voulait ces articles pour autre chose que son utilisation personnelle.
Le JSTOR bloque l'accès à tout le MIT
Il ne se trompait pas. Selon l'acte d'accusation du gouvernement contre Swartz, ces «téléchargements rapides et massifs et demandes de téléchargement entravaient la capacité des ordinateurs utilisés par le JSTOR à fournir des articles aux institutions de recherches clientes».
Le JSTOR détecta un problème et bloqua l’adresse IP de Swartz. Le jeune homme s’en procura une autre et recommença. Le JSTOR bloqua toute une gamme d’adresses IP du MIT. Puis il entra en contact avec le MIT, qui entreprit des démarches pour interdire à l’ordinateur de Swartz l’accès à son réseau.
L’acte d’accusation dit que Swartz réussit à contourner leurs dispositifs de sécurité et se procura également un autre ordinateur, utilisant les deux pour télécharger davantage d’articles du JSTOR. Cela aurait eu pour conséquence de faire crasher certains serveurs; en réaction, autour du 9 octobre 2010, le JSTOR bloqua l’accès à sa base de données à tout le MIT.
Vers cette époque, Swartz cessa les téléchargements pendant un mois environ, probablement parce qu’il s’était rendu à Washington D.C. avec Wikler pour participer, en tant que bénévole, à la préparation des élections de mi-mandat de 2010.
Lorsqu’il revint à Cambridge en novembre, il recommença à télécharger. Cette fois, il décida d’anticiper toute interdiction d’IP sans fil en branchant directement son portable Acer au réseau du MIT.
Une longue tradition d’ouverture et de liberté...
Logiquement sans doute, les bâtiments du MIT sont désignés par des numéros au lieu de noms. Les étudiants suivent des cours dans le bâtiment 3 (génie mécanique) et prennent leurs repas dans le bâtiment W20 (centre des étudiants).
Le bâtiment 16 est l’une des structures les moins essentielles du campus. C’est un connecteur qui renferme le Centre de ressources de langues et de littératures étrangères, la Division de médecine comparative et, au sous-sol, une armoire électrique et de téléphonie juste derrière une double porte arborant un panneau Danger.
Quand Aaron Swartz entra pour la première fois dans la Salle 16-004t fin 2010, ni le bâtiment ni l’armoire n’étaient verrouillés, ce qui n’avait rien d’inhabituel. Le MIT est l’une des universités les plus ouvertes du pays.
Son édifice phare, le majestueux bâtiment 7, est toujours ouvert au public. De là, on peut accéder sans aucun problème à presque tous les espaces du campus central par un réseau de couloirs labyrinthiques.
Et les étudiants ne sont pas les seuls à aller et venir comme bon leur semble. Pendant des années, des troupes de théâtre locales ont utilisé les salles de classe vides comme espace de répétition.
La politique de libre accès du MIT est un héritage de la culture créée par Richard Stallman et l’AI Lab. À l’époque où il n’y avait que très peu d’ordinateurs là-bas, certains professeurs et administrateurs avaient pour habitude de verrouiller les salles qui abritaient les précieux terminaux.
Stallman et ses homologues hackers, qui estimaient que les ordinateurs appartenaient à quiconque travaillait dessus, considéraient une porte verrouillée comme un affront personnel. Comme le décrit Steven Levy dans Hackers, ils se donnèrent beaucoup de mal pour accéder aux postes —forçant des serrures, rampant dans les faux-plafonds, allant jusqu’à employer la force pour ouvrir une porte.
Trente ans plus tard, le MIT a récupéré avec enthousiasme la légende du hacker, vendant l’idée que l’innovation et le progrès ne doivent connaître aucune barrière. Ce principe est un élément essentiel de la culture de l’université, et des «piratages» légendaires —des farces sophistiquées remontant jusqu'aux années 1860— sont célébrés sur le site d'accueil du MIT et les pages des anciens élèves.
La liste des meilleurs figurant sur le site hacks.mit.edu comprend la fois où, en 1994, les étudiants ont «changé les inscriptions à l’intérieur du Lobby 7, de “Établi pour l’avancement et le développement de la science et de ses applications à l’industrie, aux arts et à l’agriculture” en “Établi pour l’avancement et le développement de la science et de ses applications à l’industrie, aux arts, aux loisirs et au piratage.”»
... mais une «ouverture» actuelle bien loin des idéaux des hackers
Mais si les étudiants du MIT et les anciens élèves goûtent l’image d’insouciance de l’école, cela fait longtemps que l’université n’est plus «ouverte» de la manière dont l’entendaient les pirates d’AI Lab. Les convictions communautaires à tendance socialiste de l’équipe de Stallman sont des abominations pour le MIT, qui se consacre dans une large mesure aux recherches pour le gouvernement et des groupes industriels.
Le site Internet de l’université se targue de «figurer au premier rang de la recherche et du développement et des dépenses de développement financés par l’industrie de toutes les universités et grandes écoles dépourvues d’école de médecine».
Compte tenu de sa dépendance au gouvernement et aux financements des entreprises, le MIT a tout intérêt à nommer des administrateurs capables de parler cette langue. La présidente de l’école à l’époque où Swartz pirata le JSTOR était Susan Hockfield, neuroscientifique de formation, volontiers intransigeante et qui ne semblait pas intéressée par le maintien de l’image d’ouverture de l’université.
«Quand vous alliez au deuxième étage du MIT, vous passiez devant le bureau de la présidente, et la porte était fermée; vous passiez devant celui du vice-président, la porte était ouverte», se rappelle Robert Swartz, le père d’Aaron, qui travailla comme consultant pour le Media Lab du MIT:
Le MIT, de moins en moins tolérant
De nombreuses sources suggèrent que, sous la férule de Hockfield, l’université était devenue bien moins tolérante vis-à-vis d’incidents qui, aussi inoffensifs soient-ils, pouvaient potentiellement nuire à son image. En 2007, par exemple, une étudiante du nom de Star Simpson fut arrêtée à l'aéroport de Logan après que des responsables de la sécurité prirent des circuits imprimés sur son pull pour une bombe.
Simpson ne pensait pas à mal, mais l’événement pouvait potentiellement nuire au standing du MIT aux yeux du public et du secteur. Le MIT publia un communiqué de presse critiquant les actes «irresponsables» de Simpson, et ne lui proposa aucune sorte d’aide lors des épreuves judiciaires qu’elle eut ensuite à subir (Hockfield exprima plus tard ses regrets à propos de la gestion de la situation).
Voilà ce qu’était le MIT fin 2010: une institution qui laissait ses portes ouvertes, mais qui regardait de travers quiconque sortait du droit chemin.
Lorsque la police du MIT apprit que quelqu’un s’était connecté au système informatique de l’école, rien de surprenant qu’elle ait monté un piège pour attraper le coupable. Et il n’était pas particulièrement surprenant non plus que ce coupable s’avère être Aaron Swartz.
Le 6 janvier 2011 à 12h30, Aaron Swartz retourna dans la Pièce 16-004t pour récupérer l'ordinateur portable et le disque dur externe qu'il avait dissimulés sous une boîte. L'endroit avait déjà été mis sous surveillance.
Moins de deux heures plus tard, indique le procès-verbal de la police de Cambridge, un agent aperçut Swartz sur son vélo. Le jeune homme tenta d'échapper à la police en s'enfuyant à pied, mais il fut rapidement appréhendé.
Six mois plus tard, il fut inculpé par l'État fédéral pour le téléchargement d'environ 4,8 millions d'articles sur la base de données JSTOR. En 2012, les charges retenues contre lui furent alourdies, portant de 4 à 13 le nombre de chefs d'accusation.
Une lutte depuis l’enfance pour l’information libre
Depuis l'enfance, Swartz œuvrait pour une information libre et ouverte. Telle était la promesse du Web sémantique et de Creative Commons; telle était la philosophie au cœur de son travail pour Open Library et PACER. C'était l'évidence: il fallait faciliter l'acquisition et l'étude des données.
En 2008, il avait rédigé le Manifeste de la guérilla pour le libre accès:
À l'époque, ce texte n'a pas dû émouvoir les foules. Swartz avait l'habitude de faire dans la provocation en se prenant plus ou moins au sérieux.
Adolescent, il s'interrogeait sur la «logique absurde» des lois prohibant la diffusion et la possession de pornographie infantile. En 2006, il estimait que la musique devenait objectivement meilleure, et que le Clavier bien tempéré de Bach était peut-être inférieur à l'album de 2005 de Aimee Mann The Forgotten Arm.
Mais après l'histoire du JSTOR, le Manifeste prit une autre ampleur. Il fut versé comme preuve par l'accusation pour démontrer que Swartz avait l'intention de diffuser les articles téléchargés.
Le ministère public considérait que Swartz avait «dérobé une partie substantielle des archives dans lesquelles avait investi le JSTOR [...] dans l'intention de [les] mettre à disposition sur un ou plusieurs sites de partage de fichiers». Ce que la famille et les amis de Swartz contestent à l'unanimité.
Le procureur principal, Stephen Heymann, n'était pas du genre à faire preuve de clémence. En 1997, il avait rédigé un article intitulé «Punir la cybercriminalité» pour le Harvard Journal on Legislation, dans lequel il appelait le Congrès à s'attaquer aux défis inédits posés par les délinquants de l'ère numérique. «Le fait que les ordinateurs puissent effectuer la même tâche qu'un humain des millions de fois plus vite démultiplie incroyablement la capacité de nuisance d'un seul acte», écrivait-il ainsi.
Une loi «parfaite» ou «fourre-tout»
Swartz était accusé d'avoir enfreint l'article 1030 du Code pénal fédéral américain, ou Computer Fraud and Abuse Act de 1984 (on lui reprochait aussi d'avoir violé les articles 2, 981, 982, 1343 et 2461). Dans sa publication de 1997, Heymann érigeait ce CFAA en modèle, le qualifiant de «législation parfaite contre le crime informatique».
Tout le monde n'est pas de cet avis. Cette loi est «un fourre-tout notoire», constatait récemment Emily Bazelon dans Slate.com:
En 2006, par exemple, une femme du Missouri appelée Lori Drew a persécuté sa jeune voisine sur Internet; la jeune fille, Megan Meier, a fini par se suicider. Drew a été inculpée au niveau fédéral au nom de l'article 1030 pour non-respect des conditions d'utilisation de MySpace.
Dans un mémoire amicus curiae, l'Electronic Frontier Foundation a fait valoir que, aussi dramatique que soit le suicide de Meier, poursuivre Drew sous ce chef d'inculpation n'avait pas de sens —cela constituait «une dangereuse dilatation du CFAA [...] qui rendrait passible de poursuites pénales le comportement quotidien de millions d'internautes» (Drew a finalement été reconnue coupable d'infraction mineure au CFAA, mais le verdict a été annulé par la suite).
SOPA et PIPA, deux projets de loi insupportables
Alors qu'il était aux prises avec la justice, Aaron Swartz s'est intéressé à une autre loi anti-piratage que les activistes du Web estimaient irréaliste: le Stop Online Piracy Act (SOPA). Tel que présenté devant la Chambre des représentants, ce projet de loi entendait renforcer le droit de propriété intellectuelle en permettant au législateur de fermer les sites (et éventuellement d'arrêter leurs propriétaires) qui diffusaient en streaming ou hébergeaient sans autorisation du contenu sous copyright.
Les grands groupes de médias faisaient pression depuis des années pour que le Congrès légifère sur les atteintes au copyright. Le SOPA était le descendant direct du Combating Online Infringement and Counterfeits Act («projet de loi contre les infractions et les contrefaçons sur Internet»), débattu au Sénat en 2010, jusqu'à ce que le sénateur Ron Wyden lui fasse un sort en commission. Un projet de loi révisé fut à nouveau soumis au Sénat en 2011, sous le nom de PROTECT IP Act ou PIPA, législation jumelle du SOPA.
Lors de sa première présentation en octobre 2011, le SOPA était soutenu par les grands groupes de médias et la Chambre de commerce américaine. Mais les activistes du Web ne tardèrent pas à dénoncer ce qu'ils considéraient comme une offensive inepte, une attaque contre la cyberculture qui étoufferait toute créativité, favoriserait les grands groupes aux dépens des petits indépendants et condamnerait de fait l'Internet libre, ouvert et non commercial.
Le mouvement d'opposition au SOPA et au PIPA n'attendait que Swartz. Il incarnait tout ce pour quoi le jeune homme travaillait et tout ce en quoi il croyait: réforme du droit de la propriété intellectuelle, culture collaborative, libre accès aux données, militantisme politique. Malgré les poursuites entamées contre lui, ou peut-être à cause d'elles, Swartz décida de partir au front.
Des lois vaincues grâce à Swartz
Avant son arrestation, le jeune homme avait séjourné à Providence (Rhode Island) afin de participer à la campagne électorale du jeune conseiller municipal David Segal, qui briguait un siège au Congrès. L'élection fut perdue, mais Segal et Swartz, devenus amis, créèrent ensemble Demand Progress, dans le but de «promouvoir les réformes progressistes pour les citoyens ordinaires, grâce à l'organisation et au lobbying par la base».
Swartz fit des discours, persuada d'autres organisations d'entrer dans la lutte et mit au point divers outils pour permettre aux citoyens d'entrer en contact avec le législateur et d'exprimer leur opposition au SOPA et au PIPA. Face à cette gigantesque vague de contestation, le Congrès dut faire marche arrière en janvier 2012: le SOPA et le PIPA avaient vécu.
Aaron Swartz lors d'un rassemblement contre SOPA et PIPA / Daniel J. Sieradski via Wikimedia Commons
Plusieurs personnes impliquées dans le mouvement estiment que, sans la participation de Swartz, ces lois seraient peut-être passées. Holmes Wilson, dont le groupe Fight for the Future a largement contribué au black-out de Wikipedia et d'autres sites réputés, pense que Swartz et son organisation ont permis d'élargir l'éventail de diffusion du message anti-SOPA:
Quelques mois après cette victoire, Swartz est intervenu lors d'une conférence à Washington sur les enseignements à tirer de la lutte anti-SOPA. Ces projets de loi n'avaient pas dit leur dernier mot, a-t-il prévenu:
Si la victoire contre le SOPA et le PIPA fut bien réelle, la fin de la campagne de contestation ramena Swartz dans une autre réalité. Ses amis avaient été assignés en justice.
Et bien que le JSTOR eût renoncé aux poursuites, le gouvernement, avec le soutien tacite du MIT, ne lâchait pas prise. «Un vol est un vol», avait déclaré la procureure générale Carmen Ortiz en juillet 2011, «que ce soit au moyen d'un ordinateur ou d'un pied-de-biche, et qu'il s'agisse de documents, de données ou de dollars».
Malgré son attachement à Cambridge, Swartz sentit qu’il lui fallait s’en aller. À partir de la mi-2011, il passa plus de temps à New York, et c'est à cette époque qu'il se rapprocha de son amie Taren Stinebrickner-Kauffman.
Militante ayant travaillé pour Avaaz avec Ben Wikler, Stinebrickner-Kauffman avait rencontré Swartz l'année précédente à Washington. Ils partageaient les mêmes centres d'intérêt et une histoire similaire («On s'amusait de notre situation un peu confuse», raconte-t-elle. «Aux yeux du recensement, on aurait pu passer pour deux jeunes célibataires ayant laissé tomber les études et vivant ensemble dans un studio.»)
L'amour s'infiltra peu à peu dans un terrain accidenté. «Le mois où on a commencé à sortir ensemble, il a laissé tomber deux boulots, rompu avec sa petite amie, déménagé de Cambridge à New York et il a été inculpé», poursuit Stinebrickner-Kauffman. «C'était un moment difficile pour lui.»
Seul contre le système
Ils s’installèrent à New York, dans un studio de Crown Heights, à Brooklyn. Une fois achevée la bataille contre le SOPA, l'affaire JSTOR aspira tout le temps et l'énergie de Swartz.
«Au départ, quand on était à New York, il prenait le bus pour Boston tous les lundis pour se présenter au tribunal à 9h du matin et prouver qu'il ne s'était pas enfui», se souvient Wikler. Swartz ne discutait de l'affaire qu'avec son père et ses avocats; il ne voulait pas que ses amis y soient mêlés, que d'autres personnes soient citées à comparaître.
La pression ne pesait que sur lui, et sur Stinebrickner-Kauffman. «Il ne s'autorisait pas à compter sur les autres», commente-t-elle. «Mais cette force était synonyme de solitude».
Être le dernier des braves à lutter contre un monde corrompu était une perspective séduisante, surtout pour un idéaliste tel que Swartz. Cela impliquait pourtant de ne pas laisser voir à ses adversaires qu'il était atteint.
«Il tenait à ce que tout semble normal», témoigne Stinebrickner-Kauffman. C'est pourquoi il continua, comme il l'avait toujours fait, à s'engager dans de nouveaux projets, en devenant par exemple chroniqueur régulier pour The Baffler, publication de gauche fraîchement ressuscitée.
«Aaron était la personne la moins prétentieuse du monde», raconte John Summers, rédacteur en chef du Baffler. «Il était prêt à discuter pendant des heures pour remettre sur pied un magazine papier.»
Besoin d’argent
Cependant, Swartz n'avait plus les moyens de papillonner. Pour assurer sa défense, il avait besoin d'argent. Tandis que la femme de Lawrence Lessig, Bettina Neuefeind, mettait en place un fonds de financement pour sa défense, il commença, à contrecœur, à demander leur aide à des relations aisées.
En août 2012, Jeff Mayersohn, propriétaire de la librairie indépendante Harvard Book Store, reçut un mail de son ami. Il accepta de contribuer et suggéra d'organiser des réunions pour récolter davantage de fonds. Swartz refusa. «J'ai déjà eu du mal à te demander ça», se justifia-t-il.
Pendant ce temps, il devenait évident que le dossier du ministère public n'était pas très bien ficelé. Dans la nouvelle mise en accusation du 12 septembre 2012, il était reproché à Swartz d'avoir «manœuvré pour entrer par effraction dans l’armoire électrique du MIT». Or, la porte n'était pas verrouillée et était même restée ouverte après que l'université et les autorités s’aperçurent qu'on y était entré pour essayer d'accéder au réseau de l'école.
L'accusation reprochait également à Swartz d'avoir «manœuvré afin […] d'accéder sans autorisation au réseau du MIT, au moyen d'un commutateur situé dans cette armoire» et «pour accéder aux archives d'articles numérisés du JSTOR grâce au réseau informatique du MIT».
Cependant, Alex Stamos, expert indépendant engagé par la défense de Swartz, était fin prêt à répliquer: selon lui, Swartz avait en fait eu l'autorisation tacite d'accéder au réseau du MIT, vu le laxisme de l'université en termes de sécurité-réseau.
Dans un post publié sur son blog après la mort de Swartz, Stamos a exposé que le réseau informatique du MIT était extraordinairement poreux —«en douze ans de carrière dans la sécurité, je n'ai jamais vu un réseau aussi ouvert»— et que c’était délibéré, car «en accord avec la philosophie de l'université».
Le site du JSTOR, poursuit-il, «ne prévoyait même pas les procédures de contrôle les plus élémentaires pour empêcher ce qui pourrait être considéré comme une violation du système, tel que l'exigence d'un CAPTCHA en cas de téléchargements multiples».
Swartz, insistait la mise en accusation, avait en outre «manœuvré pour […] que cet accès lui permette de télécharger une partie substantielle des archives du JSTOR sur ses ordinateurs et ses disques durs» et pour «contourner les mesures du MIT et du JSTOR visant à empêcher cette copie massive, mesures visant les utilisateurs en général, et la conduite illégale de Swartz en particulier».
Mais là encore, il y a matière à débat. Stamos avance ainsi que les procureurs ont «échoué à démontrer que ces téléchargements avaient entraîné de quelconques dommages pour le JSTOR ou le MIT, sauf ceux imputables à la réaction idiote et excessive consistant à bloquer tout accès au JSTOR, alors que l'auteur des téléchargements était facilement identifiable».
Un avocat confiant…
«Nous avions un très bon expert», commente Elliot Peters, l'avocat de Swartz. «Il nous avait aidés à comprendre le fonctionnement du réseau du MIT et la façon d'accéder au JSTOR. Et il me semblait que cet accès ne s'était pas réalisé de façon non autorisée.»
Swartz avait engagé Peters, associé du cabinet de San Francisco Keker & Van Nest, en octobre 2012. Peters, qui a également représenté Lance Armstrong, était le troisième avocat de Swartz.
Au fil des semaines, il croyait de plus en plus aux chances de son client et avait l'intention de battre en brèche un certain nombre de pièces à conviction que les procureurs comptaient utiliser pendant le procès. «Nous avons déposé plusieurs requête en suppression [de pièce à convictions], dont une concernant la fouille de l'ordinateur portable et de la clé USB d'Aaron, parce qu'ils ont mis 34 jours à produire le mandat de perquisition après la saisie», précise-t-il.
Le 14 décembre, Peters et le procureur Stephen Heymann étaient entendus par le juge Nathaniel M. Gorton, qui fixait une audition de témoins pour le 25 janvier 2013. Quelques jours plus tard, les procureurs remettaient 170 mégaoctets de nouvelles pièces à conviction, qui ne rendianet les avocats de Swartz que plus optimistes.
On y trouvait en effet la trace de contacts entre Heymann et la police antérieurs à l'arrestation de Swartz. Peters était certain que cette nouvelle donne renforçait la position de la défense.
Le 9 janvier 2013, Peters a appelé Heymann pour discuter de l'audition à venir. Peters se rappelle:
…mais un procès inévitable
Mais le procureur y est allé du même vieux refrain: le ministère public n'accepterait en aucun cas un arrangement qui n'inclue pas d'emprisonnement, et s'il y avait procès et que Swartz était condamné, il requerrait sept ans.
Comme d'habitude, la défense et l'accusation ne trouvaient pas de terrain d'entente. Les poursuites devaient donc déboucher sur un procès, à débuter le 1er avril sauf autre report.
Le 10 janvier, le lendemain de ce dernier échec à parvenir à un accord, Stinebrickner-Kauffman est rentrée à New York après un séjour à la campagne. Swartz lui a envoyé un SMS lui demandant à quelle heure elle rentrait, sans lui expliquer pourquoi. À son arrivée, il a bondi de derrière la porte en criant «Surprise!»
Stinebrickner-Kauffman était fatiguée, mais Swartz, très en forme, a insisté pour qu'ils aillent retrouver des amis au Spitzer’s Corner, un bistro du Lower East Side. Swartz s'est accordé deux de ses plats préférés: des macaronis au fromage et des toasts au fromage.
Les pâtes étaient passables, mais Swartz et Stinebrickner-Kauffman ont trouvé que les toasts figuraient parmi les meilleurs qu'ils aient jamais mangés.
Un appel dans la voiture
Le matin du 11 janvier, une semaine après qu'il eut déclaré que l'année serait belle, Swartz s'est réveillé déprimé —Stinebrickner-Kauffman ne l'avait jamais vu aussi abattu. «J'ai tout essayé pour le tirer du lit», se rappelle-t-elle. «J'ai mis de la musique, j'ai ouvert les fenêtres, je lui ai fait des chatouilles.»
Quand il a fini par se lever et s'habiller, Stinebrickner-Kauffman a cru qu'il allait l'accompagner au bureau. Mais Swartz a dit qu'il préférait rester à la maison pour se reposer. Il avait besoin d'être seul. «Je lui ai demandé pourquoi il s'était habillé», poursuit Stinebrickner-Kauffman. «Mais il n'a pas répondu.»
Cet après-midi-là, Peters étudia les pièces remises par l'accusation fin décembre. À mesure que sa lecture avançait, il devenait de plus en plus optimiste pour l'audition du 25 janvier.
«Si la requête nous avait été accordée et que les résultats de leur perquisition n'avaient pas été versées au dossier, il ne leur serait pas resté pas grand-chose pour le procès», estime-t-il aujourd'hui. «J'ai déboulé dans le couloir en criant "Regardez-moi ça!" »
Peters rangea les dossiers dans sa mallette et prit sa voiture. Pendant le trajet, il reçu un appel de Bob Swartz. Aaron s’était suicidé.
Cela fait plus d'un mois que Swartz s'est pendu, et le choc initial s’est transformé en quelque chose de plus aigu. «Je suis tellement plus en colère depuis sa mort», convient Wikler.
Il n’est pas le seul. La famille, les amis et les partisans de Swartz disent presque tous qu'ils ne s'attendaient pas du tout à son suicide. Ils ne pensent pas que Swartz était dépressif au sens médical du terme —il était lunatique et parfois excessif, mais pas dépressif.
«Je me suis renseignée sur la dépression et les troubles qui l'accompagnent. J'en ai étudié les symptômes, et avant les dernières 24 heures de sa vie, Aaron n'en présentait aucun», a écrit Stinebrickner-Kauffman sur son blog le 4 février dernier.
«La dépression est comme de l'encre qui teinte tout, qui rend tout noir et impénétrable», écrit Wikler. «Et Aaron n'était pas comme ça. C'était un être presque entièrement transparent.»
Les proches de Swartz sont également d’accord pour montrer du doigt les responsables de son suicide. «Le gouvernement et le MIT ont tué mon fils», a déclaré Robert Swartz lors des funérailles d'Aaron.
Lawrence Lessig —qui avait écrit en 2011 que les actes reprochés à Aaron, s'ils étaient avérés, étaient «critiquables sur le plan éthique»— a estimé pour sa part que le jeune homme avait été «poussé à bout par ce qu'une société honnête ne pourrait que qualifier de harcèlement».
Et maintenant?
La vérité est certainement plus complexe. Les circonstances de la vie de Swartz résistent à toute simplification, et il en va de même pour sa mort. Quoi qu'il en soit, si les partisans de Swartz croient comprendre son geste fatal, il leur est plus difficile de répondre unanimement à une autre question: Et maintenant?
Les cérémonies funèbres et les innombrables oraisons en ligne ont proposé autant de pistes pour honorer dignement la mémoire de Swartz: réforme du Computer Fraud and Abuse Act, accès facilité aux sources universitaires, utilisation de la réglementation sur les archives publiques pour donner libre accès aux documents de l'État.
De son côté, le collectif Anonymous a piraté le site du MIT dans la nuit du 13 janvier et court-circuité le réseau de l'université au moyen d'une attaque par déni de service pour publier une liste de «Souhaits», parmi lesquels figurent: «Réforme des lois sur la cybercriminalité», «réforme des lois sur la propriété intellectuelle et le copyright» et «engagement renforcé et résolu pour un Internet libre, sans entrave ni censure, qui garantisse à tous une égalité d'accès et d'action».
(Le MIT est en train de mener une enquête interne sur son rôle dans l'affaire Swartz. L'homme dirigeant l'enquête, le professeur Hal Abelson, est l'un des principaux fondateurs de Creative Commons et il siège au conseil de la Free Software Foundation de Richard Stallman.)
Il faut s'attendre à ce que l'héritage de Swartz fasse débat, et il faut peut-être s'en réjouir. Swartz agissait en accord avec ses convictions et poussait son entourage à faire de même. Mais comment s'accorder sur la suite à donner à la mission qu'il s'était fixée, quand celle-ci a épousé des formes si nombreuses et si variées?
Que reste-t-il d’Aaron Swartz?
«Il y a une vieille blague entre programmeurs sur l'avenir réservé à un code dont l'auteur mourrait renversé par un camion», écrivait Swartz en 2002, dans un post détaillant ce qu'il conviendrait de faire de son travail s'il mourait inopinément. Il désirait que son code continue à être amélioré et qu'il reste ouvert, en hommage aux combats de sa vie et à ce qu'il laisserait derrière lui.
Au final, que laisse Aaron Swartz? La moitié des sites qu'il a créés dans son enfance ne sont plus. Ou plutôt, ce sont des fantômes qui errent quelque part dans l'Internet Archive de Brewster Kahle.
L'Info Network n'est plus. Le fan club de Star Wars du Chicago Force a changé de site. Le RSS 1.0 a vite été éclipsé par son rival le RSS 2.0. Et l'un et l'autre ont été détrônés par le nouveau format Atom.
Infogami a été un échec. Jottit aussi. Reddit n'a connu le succès que bien des années après le départ de Swartz. watchdog.net n'a pas été refinancé. Le Web sémantique n'a jamais vraiment pris.
Qu'a-t-il donc accompli, ce savant universel, hyperactif et lunatique, qui n'a pas achevé la moitié de ce qu'il avait entrepris? Swartz a connu des réussites, bien sûr. Son action a été déterminante pour mettre un frein au SOPA, et Creative Commons ainsi que Demand Progress restent l'émanation de sa croyance inaltérable en un accès et un Internet libres.
Mais le plus souvent, Swartz a dû compter avec l'échec. Résoudre des problèmes simples ne l'intéressait pas. Il voulait structurer le monde, alors que le monde est chaotique; il voulait réformer les systèmes, mais était déprimé quand, malgré ses tentatives répétées, les systèmes résistaient.
«Je me souviens avoir discuté avec lui des collaborations qui n'avaient pas fonctionné», raconte son ami Nathan Woodhull. «Je crois qu'en fait, les gens n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Il savait à quoi il voulait arriver, et on ne se situait pas au niveau.»
Il y aurait davantage de gens comme Aaron Swartz si nos écoles, nos entreprises et nos gouvernements étaient configurés de manière à produire davantage de Aaron Swartz —s'ils étaient souples, réactifs et adaptés à chacun, s'ils encourageaient la collaboration et l'esprit d'initiative, s'ils incitaient à vivre pleinement ses passions et ses idées.
Mais les grands systèmes ne sont pas comme ça. Les idéalistes seront toujours la minorité, celle qui fait tout pour perfectionner un monde qui ne sera jamais parfait.
Son idéalisme se répand
Dans les années 1980, Richard Stallman a vu ses amis lâcher leurs idéaux pour se faire de l'argent avec des codes propriétaires. Lui a choisi une voie différente en fondant la Free Software Foundation et en agissant selon ses principes, il a choisi la voie de la résistance.
Qu'a accompli Stallman? Pas grand-chose, si l'on s'arrête au fait que la majorité continue d'utiliser Windows et Mac OS.
Mais il a inspiré Lawrence Lessig et un enfant précoce nommé Aaron Swartz, qui possédait une carte de membre de la Free Software Foundation, hébergeait sur son site le PDF d'un recueil d'essais de Stallman, et qui déclara, après avoir écouté le chercheur lors d'une conférence, que c'était le type d'homme qu'il se voyait devenir.
Dans le mois qui a suivi sa mort, l'idéalisme de Swartz a commencé à se répandre. Internet facilite l'activisme —il ne faut qu'une seconde pour retweeter une pétition.
Swartz était plus exigeant, il voulait un monde où tous ordonneraient leur vie selon leurs convictions, pas selon ce qui est le plus rentable. Peu de temps après sa disparition, ses amis ont créé un site à sa mémoire où qui veut peut laisser un message sur sa vie et son œuvre.
Les commentaires de ses proches sont bien moins nombreux que ceux de parfaits étrangers, de personnes du monde entier qui n'avaient jamais rencontré Swartz, et qui n'avaient même pour certains jamais entendu parler de lui avant sa mort.
«Quel malheur qu'un être si brillant et passionné [meure] de façon si tragique», a écrit un certain Jason dans un éloge bref et sincère intitulé «Il faut changer les choses»:
Quand il vivait dans le Massachusetts, Swartz participait chaque année à la Mystery Hunt du MIT, une course aux énigmes d'un week-end. Exactement une semaine après sa mort, le premier jour de la Mystery Hunt 2013, son ancienne équipe a organisé une dégustation de glaces à sa mémoire.
Une grande banderole était étalée sur la table, sur laquelle amis et admirateurs pouvaient écrire de petits mots: souvenirs amusants, messages de condoléances, etc. À la fin de la soirée, un garçon élancé vêtu d'un sweatshirt, qui avait l'air trop jeune pour être là, s'est approché de la table. Au marqueur, il a simplement écrit: «Nous continuerons.»
Justin Peters
Traduit par Bérengère Viennot et Chloé Leleu
[1] Traduction collective issue du site framablog (NdT). Retour à l'article.


 Mots clés:
Mots clés: PRÉC
PRÉC







