Combien de fois<
15 décembre 2021
Texte paru dans le n° 11 de la revue papier Ballast (mai 2021)
Il y a deux jours, nous publiions un entretien avec l’écrivain et poète Claro, auteur, à ce jour, d’une vingtaine de livres. Nous publions aujourd’hui huit petits textes de sa composition, initialement parus dans notre revue papier. Il y est question, pêle-mêle, d’une ferme et de Baudelaire, de pizzas et de la population mondiale, d’un wagon et de chaussures usées, d’un journal algérien et d’un nom de fleur.
À côté de la plaque
La ferme, bien sûr, c’était pour l’aîné, et l’aîné lui aussi semblait fait pour la ferme, personne n’aurait eu l’idée de contester le bien-fondé de cette passation, comme si les mots « bien-fondé » et « passation » eux-mêmes étaient des pierres destinées à lester le fils, le plus âgé, après le père. La ferme resterait la ferme, on changerait peut-être le papier peint dans la cuisine, il faudrait aussi agrandir, ou raccourcir, dit l’aîné en s’essayant au rire, après l’apéro. Le notaire avait ri en vissant son stylo. Puis son tour était venu, et on lui avait remis un écrin. Ou plutôt une boîte, un boîtier, quelque chose de plat et de carré, recouvert d’un vieux feutre bordeaux, qui s’ouvrait avec la déconcertante déception d’une ménagère. Dedans, une plaque de verre, assez épaisse, et lourde, sur laquelle il chercha puis devina des zones plus sombres, une forme vague, anguleuse, mais la lumière dans le bureau du notaire était chiche, il n’avait pas envie de sortir ses lunettes de son étui, il la remit en place, referma le boîtier — l’écrin usé.
De temps en temps, une fois par an, quand il avait envie de partir, ou de se pendre, ou de ne plus rien faire, de rester là, les mains sur les genoux comme des chenets, il prenait sur lui et allait chercher la boîte, qu’il avait posée le premier jour tout en haut du vaisselier et qui y avait sa place, celle des objets qu’on sait oubliés, mais pas perdus. Il sortait la plaque, la faisait miroiter devant ses yeux, y voyait toujours la même chose : des taches, comme l’avancée d’un toit, la flaque d’une cour coupée par le soleil, peut-être une silhouette, une brouette. Des taches, de toute façon. De toute façon des taches.
Son frère, il ne le voyait plus. Il passait devant la ferme, ralentissait puis prenait le sentier qui menait à un champ qu’il savait pouvoir longer afin de revenir à son point de départ, d’où ne plus jamais partir. Les années s’empilaient. Les années s’encrassaient. Il dut vendre à peu près tout, et apprendre à vivre de peu.
« Plus pour longtemps. » C’est comme ça qu’il avait compris les paroles du médecin. Un ami d’autrefois, qu’il ne reconnut pas tout de suite tant sa voiture était neuve, solide, brillante, vint le voir sans prévenir, sans même savoir que « plus pour longtemps ». Lui était en train de regarder la plaque. Il y voyait de nouvelles choses, moins tristes, mais plus définitives. L’ami parlait, commentait, riait tout seul. Puis l’ami s’était tu. On aurait dit qu’il tremblait. L’ami s’était alors levé, il avait demandé à regarder la plaque, à l’interposer entre le soleil, qui allait disparaître, et son regard qui paraissait enflammé. Puis vinrent, bredouillées, confuses et comme irradiées, les explications de l’ami. La plaque aux taches était un daguerréotype, elle était même signée, là, en bas, au dos, à l’encre pâle mais lisible — Niépce — et portait en outre une date : 15 décembre 1825. C’était, dit l’ami devenu artiste ou galeriste, la toute première photo au monde. Le mot « inestimable » fut alors prononcé. Son prix possible aussi, dans lequel on aurait pu faire tenir des dizaines de fermes, des centaines d’hectares — plusieurs vies en une.
Il reprit la plaque des mains de l’ami et la regarda une dernière fois. Là où il aurait dû distinguer, même en rêve, la cour d’une demeure dijonnaise, il ne voyait que la forme hexagonale et étirée de ce qui, au mieux, aurait pu passer pour un cercueil. Le blanc de la cour, découpée irrégulièrement, évoquait quant à lui un tissu tombé, à peine dentelé. Il ne manquait à ce tableau défunt que l’ombre de son frère pour parfaire le cauchemar.
Plus vieux que
Sa première pensée, au réveil, après une nuit tout en évitements et cahots : moins une pensée d’ailleurs qu’un constat, issu d’un calcul incongru : il était désormais plus vieux que Baudelaire. Le café, bien qu’amer et brûlant, ne parvint pas à chasser cette idée qui cherchait à s’imbriquer durablement dans sa conscience, mais en quel endroit et dans quel but, aussitôt son appétit coupé il retourna se coucher. Indifférent à la poésie pour ce qu’il en savait, ayant sans doute retenu les dates de naissance et de mort du poète à son insu, dans son enfance ou celle de son fils au détour d’un devoir, il dut se livrer à une arithmétique sommaire pour se voir confirmer ce que le rêve lui avait légué. Mort à quarante-neuf ans, Baudelaire. Il en avait, lui, six de plus. Mais alors que les chiffres auraient dû se replier sur eux-mêmes et le laisser en marge de leur fausse énigme, il s’offrit le luxe un peu oisif de développer cette révélation sans éclat.
Il se releva, alla dans le salon, prit une chaise et s’assit devant le mur nu où aurait dû palpiter l’écran de la télévision qu’il avait jeté la semaine précédente. Le mur l’aiderait à penser, à se concentrer, comme autrefois, seul, face à un autre mur, à la faveur d’une punition, au fond de la classe. Il attendit ainsi dix bonnes minutes, retournant la pensée dans sa tête comme une salade dans un bol — c’est du moins l’image qui lui vint à l’esprit, et qui l’empêcha de parvenir à la moindre conclusion.
Il chassa l’image, essorant la salade puis la mâchant feuille à feuille. Une interrogation, alors, s’insinua : était-il possible d’être plus âgé qu’un mort, fût-il poète ? Si je suis plus vieux qu’un cadavre aujourd’hui intégralement décomposé, suis-je encore vivant ? Il y avait derrière tout ça, il le sentit, une logique d’un genre inquiétant. Plus vieux qu’un mort. C’était différent que d’être vivant. Ça n’empêchait pas d’être vivant, sans doute, mais c’était différent. Il lui manquait un élément pour que les pièces se mettent en place. Pour que le message de la nuit livre son sens.
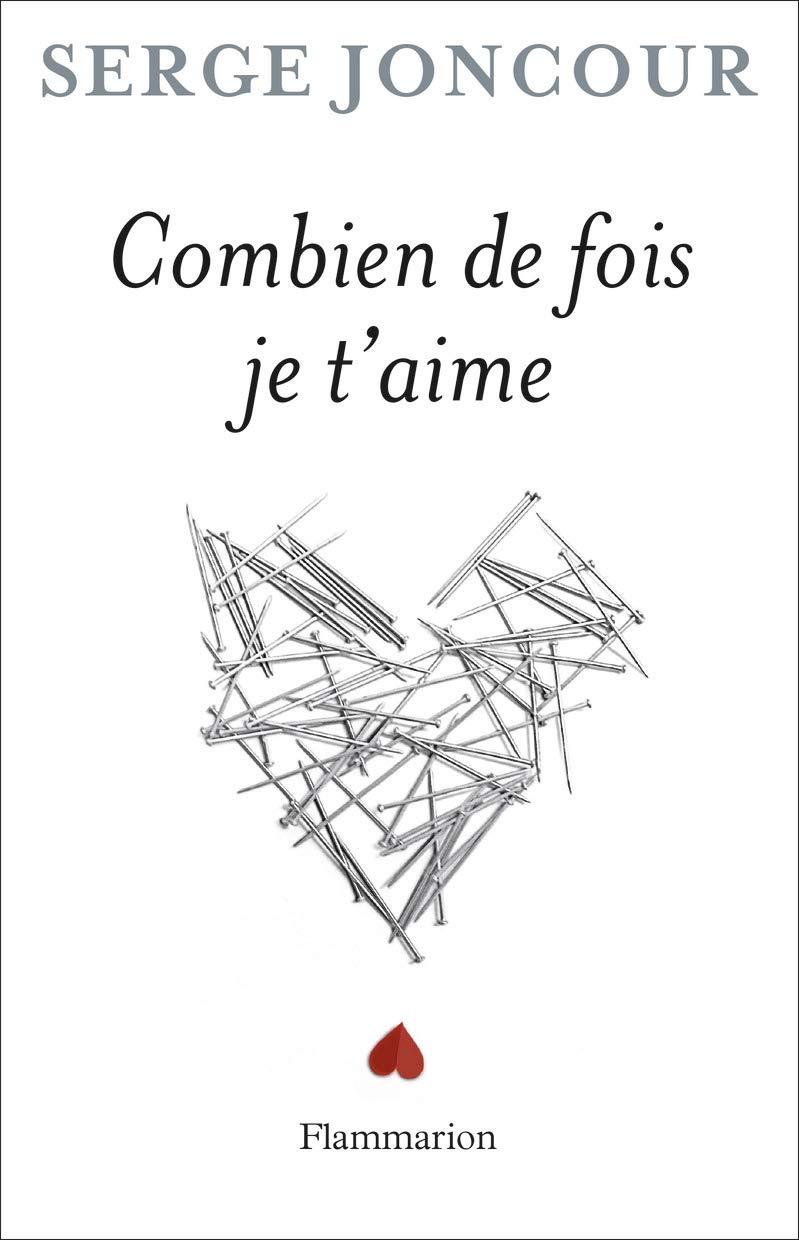
Il envisagea de se lever, d’aller ouvrir un livre de Baudelaire, mais il eut l’impression que ce serait tricher. Peut-être prenait-il le problème par le mauvais bout ? Il se dit alors que Baudelaire, bien que mort, continuait de vieillir, à sa façon ; que, dans sa tombe, il continuait, nécessairement. Le processus de décomposition n’était, après tout, que l’accélération d’un phénomène qui devait commencer à la naissance, voire avant. Mais Baudelaire ne le rattraperait pas. Il serait toujours plus vieux que le poète, même si Baudelaire avait été encore en vie. Baudelaire serait toujours plus jeune que lui. Pour aller contre ça, il aurait fallu que lui meure plus tôt, disons à l’adolescence. S’il était mort à dix-sept ans, d’une maladie, ou d’un accident, alors jamais Baudelaire n’aurait été, même mort, plus jeune que lui. Et peut-être Baudelaire s’était-il réveillé un matin, harcelé par une pensée similaire, une de ces pensées qui non seulement ne mènent à rien, mais égarent, dispersent, troublent, et finissent, au fil des ans, par vous miner, vous ronger.
Il se leva de la chaise et s’approcha lentement de la fenêtre ouverte.
Note de chevet
Il ne savait jouer d’aucun instrument. Mais il acheta un piano — sans avoir jamais pris de leçon. Il renonça à s’inscrire au conservatoire. N’alla pas aux concerts. Attendit des mois avant de soulever le couvercle noir. Il tapait sur les touches pendant des heures. Se prit pour un prodige en riant. Y passa des heures, inlassable. Tenta d’improviser un morceau continu. Chantait. Le prit pour confident. L’insultait : piano pourri, piano chéri. S’y meurtrit les phalanges. Lui lécha les touches. Fit des gammes sataniques. Désespérait, insistait. S’y mettait à deux heures du matin, avec ferveur. Découvrit Glenn Gould, reprit des berceuses. (Fut vendeur de pizza pendant trois mois.) Il le réclamait dans son sommeil. Se prit les doigts de la main droite dans la portière d’un taxi. Il rêvait de moins en moins : piano chéri, piano pourri. (Enterra ses parents à deux semaines de distance.) Il en jouait désormais jour et nuit, même de loin. Sut qu’il ne saurait jamais, ni en jouer ni ne pas en jouer. Prit de plus en plus de médicaments. Joua sans jouer jusqu’à l’épuisement. Arracha les touches les unes après les autres. Se coucha sur les cordes, capot ouvert. Y fit ses nuits. Entendit tout. N’y comprit rien. Pleura. Pleurait. Plainte pâle du piano — chut.
N+ 1
Il avait lu dans un magazine ceci : si plus de la moitié de la population mondiale — autrement dit : n+ 1 — fermait au même moment les yeux et niait la réalité, cette dernière cesserait alors d’exister, puisque la philosophie nous apprend qu’elle est le fruit de nos sens. Il avait compris, aussi, qu’une telle chose ne se produirait pas, mais qu’étant possible, elle n’en était pas moins concevable. Il rechercha longtemps le magazine où était exposée cette idée. Il interrogea sa femme, ses enfants, même l’employée de maison. Personne ne voyait de quel magazine il voulait parler. Il fit des recherches sur Internet, mais il était difficile, apparemment, de synthétiser sa demande avec des mots-clés.
La moitié +1. Et s’il était, précisément, et très concrètement, lui, ce « +1 » ? S’il lui suffisait, maintenant, là, dans la cuisine, de fermer les yeux et de nier la réalité de la réalité ? Les chances pour que la moitié de la population mondiale fasse la même chose que lui au même moment étaient minces, certes, mais il avait également lu que les probabilités, fondamentalement, étaient toujours de une sur deux, puisqu’à chaque relance de la statistique — il n’était pas très sûr des termes —, on repartait de zéro. N + 1. Une chance sur deux, donc, s’il avait raison, pour que tout cesse. Là. Maintenant. Ou à un autre moment. N’importe quel moment. Un moment sur deux. Réalité, puis : non-réalité. Fermer les yeux, se concentrer. Nier. Il aurait tant aimé retrouver ce magazine. Celui qui parlait de la négation de la réalité et aussi celui qui exposait le fonctionnement des probabilités. Mais le magazine qui exposait cette idée à la fois simple et incroyable, était introuvable, à croire qu’il n’avait jamais existé. Ou n’existait que dans son imagination. Si tant est que lui-même fût réel.
À bonne distance
Assis dans le compartiment, il croit ou veut dormir, les mains liées autour d’un livre, les pieds à plat sur le grondement du sol. Son esprit aspire à s’ouvrir et se fermer alternativement, autour d’une idée ou d’une image, sans heurt. Il est un peu las, c’est le soir, et rentrer chez lui va prendre du temps. Mais quelque chose l’empêche d’arriver jusqu’à lui-même. Une odeur, qui bientôt lui donne la nausée. Il ouvre les yeux. Devant lui, debout mais absent, un type gratte ses cheveux-ronces, le pantalon large comme un tronc, béant aussi. La puanteur l’entoure, le précède, l’annule presque. L’homme qui n’aspire qu’à rentrer chez lui met à profit l’arrêt suivant pour changer de wagon. Pour changer d’air et de contenance. Il trouve aussitôt une place libre, s’assoit et, presque, rêve. Mais l’odeur est revenue, d’autant plus distincte qu’il la reconnaît à présent. Il rouvre les yeux, perplexe. Le type aux cheveux-ronces est là, tout près de lui, à marmonner ou chantonner, à faussement danser d’un pied sur l’autre. L’homme qui voudrait bien rêver, somnoler, se lève sans réfléchir, s’approche des portes du wagon, attend l’arrêt suivant, descend, fait plusieurs mètres sur la gauche, monte deux wagons plus loin à l’instant où les portes, sourdes, tentent de guillotiner les retardataires. Il n’y a pas de place, pas encore, tout le monde a planté ses coudes dans l’espace de l’autre. Alors il attend, adossé aux portes donnant sur la voie et le vide. Une musique ténue, exfiltrée d’écouteurs voisins, d’une autre tête, l’aide à se bercer. Soudain, ça le reprend. Cette nausée. Ce défi. Le type est de nouveau là, toujours aussi vaseux, plus écœurant que jamais. N’en pouvant plus, l’homme qui aimerait s’éloigner de la partie comme du tout s’approche du clochard et lui demande, d’un ton plaintif, sciemment humain, pourquoi l’autre le harcèle ainsi. « Vous sentez si bon », dit le crasseux. Le fait est que l’homme qui rentre chez lui a disputé, avant de prendre le métro, une partie de squash avec une sorte d’ami, ensuite de quoi il s’est longuement lavé, allant même jusqu’à masser ses membres éprouvés avec une crème parfumée, croit-il, à l’eucalyptus. Oui, il sent bon, c’est vrai. Pourquoi ne suivrait-on pas une odeur agréable, de même qu’on en fuit une qui indispose ? Il comprend très bien. Ne change plus de wagon. Jusqu’au terminus. Il ne descend même pas. Il attend. Il sait qu’il ne peut se fuir lui-même, qu’il n’a pas de raison de se fuir lui-même. Du moins, pas encore.
Le secret du médical
Il était sorti du cabinet du médecin presque à reculons, comme devant une sommité ou une menace, les yeux baissés, presque attirés par le bout élimé de ses chaussures. Élimé : son corps l’était aussi, s’il en croyait l’oncologue distingué. Mais distingué : non, plus aucun de ses organes, plus pour très longtemps. Qu’allait-il dire aux siens, qui l’avaient toujours cru d’une santé de fer, impropre à se dérober à ses obligations ; à ses collègues, qui le savaient doucement corvéable, et prévenant ; à ses parents, qui devaient leur longévité à un caractère acariâtre et un solide entraînement ? aux commerçants, qui comptaient sur sa régularité ? Aucun traitement ne lui était prescrit, à vrai dire, puisque ses jours étaient comptés, comme des moutons, avant de s’endormir pour de bon. Du moins était-ce là ce qu’il avait cru comprendre, car les mots utilisés par le médecin demeuraient, à la semblance de ces haricots dont on n’est pas sûr de souhaiter la germination, enveloppés dans un coton humide, sortis des grosses lèvres moites de l’homme de science, de l’homme du cancer généralisé. C’est alors qu’il, en mortel précoce, se rappela cette chose fondamentale qu’était le secret médical, et non seulement se le rappela mais jugea qu’il ne pouvait seul échoir au praticien, et que lui-même se devait d’en observer les règles strictes. Il ne trahirait pas son corps. Il ne dirait rien. À personne. Il déclinerait certes, et ses carences le rendraient suspect aux admirateurs de la santé, mais il n’en démordrait pas, il préférait encore passer pour un simulateur, un fainéant, un hypocondriaque 2.0 que d’avouer que le crabe en pinçait pour lui en chaque point de son anatomie. Ce serait son dernier baroud d’honneur. Le secret médical. Le respect de cette loi d’airain ferait de lui l’égal d’un docteur. Il sentait presque son costume mincir et blanchir, devenir blouse. Son ouïe devenait stéthoscopique. Ses yeux diagnostiquaient le monde qui s’éloignait. Il percevait, tout bas, les clairs battements des cœurs alentour, le fluide écoulement des sucs dans les estomacs, le doux menuet de la respiration que l’effort relance à intervalles réguliers. Et plus il pourrissait de l’intérieur, plus on le critiquait, se moquait de lui, le bousculait presque. Et plus il percevait, comprenait, pensait. Sa mort prochaine était devenue un pur point de vue. Le testament qu’il rédigea ressemblait davantage à une ordonnance. Et le secret médical l’emporta dans la mort avec son long cortège de médisance.
Le génie des langues
Il n’y avait pas fait attention en écoutant la radio, ce matin-là. Mais une fois dans le métro, assis à côté d’un couple qui parlait une langue étrangère à la sienne, la chose devint vite une évidence. Il comprenait tout. Il ignorait si l’homme et la femme parlaient espagnol ou portugais, mais leurs phrases s’allongeaient, limpides, sur la page de son esprit. Une fois au travail, il se connecta sur divers sites étrangers, russes, chinois, wolofs. Tout était transparent. Écrite, parlée, aucune langue obscure. Le midi, pour sa pause déjeuner, il voulut franchir une autre étape. Il se rendit dans un petit boui-boui pakistanais et commanda, en paki, un plat dont le nom lui parut prometteur. Le serveur marmonna quelques mots dont il saisit jusqu’à la moindre inflexion. Entre le restau et son bureau, dans la rue, les voix avaient cessé de moduler leur diversité pour composer un ruissellement ininterrompu de propos plus ou moins intéressants. Il eut du mal à se concentrer cette après-midi-là, occupé à penser en araméen, en japonais, en finnois, ébloui jusqu’au vertige par la facilité avec laquelle les langues se partageaient son esprit. Pourtant, il décida de s’attarder après le départ de ses collègues afin de discuter avec l’homme de ménage mauritanien, dont le dialecte ne lui posa aucun problème. Il n’avait pas envie de rentrer chez lui, pas tout de suite, aussi se promena-t-il au gré des conversations, renseignant un Lituanien qui semblait perdu, plaisantant avec des Chinois. Il put enfin savoir de quoi parlaient les chansons anglaises qui sortaient des boutiques. Il acheta même un journal algérien, dans lequel il repéra quelques coquilles. Puis il songea que sa femme allait s’inquiéter. Quand il poussa la porte de chez lui, elle était là, sur le canapé, en train de fumer, ses traits usés par une inquiétude qui aussitôt se changea en une sorte de rage retenue. Elle se leva et se planta devant lui, tremblante. Puis sa bouche s’ouvrit et elle lui parla sans s’arrêter, d’un débit apeuré, pendant d’interminables minutes, enchaînant des questions qui n’en étaient plus à peine formulées. Il la regardait sans rien dire, parfaitement bouleversé, ne sachant s’il était devenu sourd ou stupide, tellement il ne comprenait pas un traître mot de ce qu’elle racontait.
Madame P.
Mais pour lui, la plus grande énigme, c’était la discrétion entourant l’épouse de l’écrivain. Oui, force était de reconnaître qu’on savait, lui en tout cas, lui surtout sans doute, fort peu de choses sur la femme de Marcel Proust. Le peu d’éléments biographiques qu’il avait glanés concernant l’auteur de La Recherche ne lui avait rien appris d’intéressant sur cette personne forcément dévouée, nécessairement attentive. Quelle avait été la part de son implication, lisait-elle chaque nouvelle version, l’assistait-elle dans ses crises d’asthme, lui avait-il montré Balbec, aimait-elle Vermeer, tout cela restait encore mystérieux, même s’il savait que l’homme et l’œuvre sont deux choses différentes, parfois étanches, du moins au regard de la postérité. Il ne savait même pas, tant les informations dont il bénéficiait étaient chiches, si elle avait survécu à son mari, à quel âge elle était décédée. Pourtant, quelque chose lui disait que c’était Proust le veuf. À le lire et le relire, il sentait de moins en moins confusément que ce dernier écrivait en veuf, en veuf passé et présent. En veuf futur. Il y avait dans sa prose quelque chose d’inconsolé, qui ne trompait pas. De là, sans doute, le sentiment qu’on avait, en le lisant, d’assister à une formidable démonstration de pudeur. À chaque page, en effet, on sentait, lui surtout, combien Proust faisait montre d’une retenue constante, s’interdisant de jamais évoquer le souvenir de son épouse, de Madame Proust, n’osant même pas la nommer, encore moins la décrire, y faire ne serait-ce qu’une allusion. Comment s’appelait-elle, d’ailleurs ? L’avait-il seulement su ? Aubépine ? Un nom de fleur, sûrement. Il se promit d’aller voir un jour sa tombe — Combray ne pouvait être loin. Et pourtant, plus il lisait La Recherche, plus il sentait Madame Proust présente un peu partout, elle semblait lui faire signe derrière Albertine, Odette, même derrière Swann ou Charlus, comme si Proust, dans son immense et douloureux veuvage, avait tenu à faire de chaque personnage de La Recherche, même des hommes, le dépositaire fragmentaire de sa mémoire.
Toutes les illustrations sont de Mathieu Pauget.
REBONDS
☰ Lire notre nouvelle « L’usine », Marc Graciano, novembre 2021 ☰ Lire notre nouvelle « La pierre de Naplouse », Jérémie Rochas, juin 2021 ☰ Lire notre nouvelle « Magnolia », Oskar Vaughn, mars 2020 ☰ Lire notre nouvelle « Que les pierres tombent », Roméo Bondon, janvier 2020 ☰ Lire notre nouvelle « Demain commence aujourd’hui », Alain Damasio, octobre 2017 ☰ Lire notre nouvelle « À l’Hôtel des morts choisies », Tristan Cabral, juillet 2017
Publié le 15 décembre 2021dans ManuscritsparClaro

 Mots clés:
Mots clés: PRÉC
PRÉC







